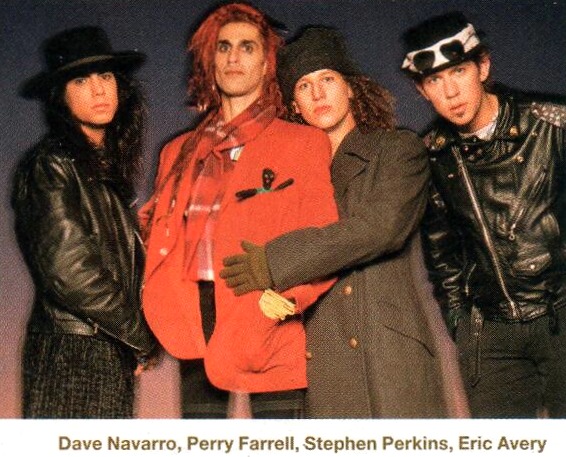Nouveau western ...
C’est un peu comme cela que le
film avait été présenté, comme si un western ne pouvait être qu’un film de John
Ford avec John Wayne … sauf que Sergio Leone avait déjà bouleversé pas mal de
codes avec « Le bon, la brute et le truand » notamment, et que
Peckinpah, alors que le tournage de « Butch Casssidy … » n’était pas
terminé, traumatisait les spectateurs avec les gunfights et les jets
d’hémoglobine au ralenti de « La Horde sauvage » …
« La Horde sauvage »
(the wild bunch dans la langue de Lady Gaga), hasard ou pas, étant justement le
nom de la bande qui accompagnait le légendaire braqueur Butch Cassidy au
tournant du siècle dans le Sud américain. Le scénariste William Goldman dut
trouver un autre nom pour les complices de Cassidy (ce sera la bande du Hole in
the Wall). Lequel Goldman avait déjà eu pas mal de soucis avec son scénario, un
des plus chers payés par un studio.
Le film doit être construit
autour d’un Paul Newman en pleine gloire (« Luke Cool Hand »), et
réalisé par un pote à lui, George Roy Hill. Pour partager l’affiche avec
Newman, la production est prête à mettre le paquet, les noms de Brando, Jack
Lemmon, Warren Beatty et surtout celui de Steve McQueen, l’autre star masculine
de l’époque circulent. Finalement, Hill et Newman réussiront à imposer un
quasi-inconnu, Robert Redford, venu du théâtre comique new-yorkais, et qui sera
le Sundance Kid.
Le scénario repose sur
l’histoire plus ou moins authentique de Cassidy et du Kid, largement réaménagée.
Cassidy et le Kid n’étaient en fait pas des Robin des Bois américains (juste
des truands n’hésitant pas à dégainer les premiers), n’étaient pas copains
comme cochons (le Kid venait de rejoindre la bande, c’est un peu par hasard que
les deux hommes et la maîtresse du Kid ont fui ensemble), la Bolivie n’a été
que la fin supposée de leur périple sud-américain, … D’un autre côté,
« Butch Cassidy … » n’a jamais prétendu vouloir être un film
historique.

Il reprend (avec un budget
conséquent) la trame du western classique, les hors-la-loi sympathiques, les
grandes poursuites, les grands espaces sauvages, … Mais c’est avant tout une
comédie, et d’ailleurs Newman dont ce n’était pas la spécialité, avait des
doutes sur le résultat final, trouvant souvent que c’était too much de ce
côté-là … Mais là où le film peut être perçu comme vraiment original, c’est
surtout au niveau du découpage et du montage. Le générique du début façon film
muet (clin d’œil au « Great train robbery », court-métrage de 1903
considéré comme le premier western ?), la longue poursuite (une demi-heure), la fuite de Cassidy et du Kid vers
l’Amérique du Sud résumée par une succession de photos sépia, le final sur une
image arrêtée… A noter aussi deux scènes peu utiles dans le déroulement du
film, mais qui ont alimenté des discussions sans fin entre les
« spécialistes », la plus controversée étant celle de la reddition à
un shérif au milieu de la poursuite (non-sens, casse la tension, etc, … tels
ont été les reproches). Mais surtout la scène dite de la
« bicyclette », qui laisse planer un doute sur la relation ambiguë
entre Cassidy et Etta Place (la maîtresse du Kid jouée par Katharine Ross),
avec en fond sonore le fameux morceau de Burt Bacharah et Hal David chanté par
B.J. Wilson (« Teardrops keeps falling in my head »), que Hill a
maintenu contre vents et marées, et surtout la bronca des producteurs qui
voulaient le remplacer par un machin country ou hillbilly traditionnel …
A sa sortie, le film a été
éreinté par la critique (c’est pas vraiment un western, c’est pas vraiment une
comédie, c’est qui ce Robert Redford, ce genre …). L’accueil du public a été
lui enthousiaste, et logiquement, l’industrie du cinéma prête à tous les
revirements pourvu que ça remplisse les caisses, a multi-nominé et
multi-récompensé « Butch Cassidy … » aux Oscars …
« Butch Cassidy and the
Sundance Kid » est une merveille de film sympa, avec pour cadre des
paysages parmi les plus somptueux jamais mis en images (tournage dans une
multitude de parcs nationaux américains, mais aussi au Mexique), des scènes
devenues mythiques, comme la partie de poker du Kid au début, celle du
strip-tease de Katharine Ross, celle de la bicyclette, celle de la poursuite
avec son questionnement obsessionnel (« Who are those guys ? »),
un trio d’acteurs majeurs Newman – Redford – Ross (même si cette dernière est
moins présente à l’écran que les deux hommes).
Et surtout, des gens qui se
sont bien amusé sur le tournage, et une complicité qui se voit entre Newman,
Redford, et George Roy Hill. Et ce n’est certainement pas un hasard si les
trois hommes se retrouveront au générique quelques années plus tard d’un film
au succès encore plus colossal, « L’arnaque » …
PS. Assez bizarrement, il me
semble que le film « passe » mieux en version DVD qu’en version
Blu-Ray dans lequel une image trop flashy et brillante dessert notamment les
scènes filmées en nuit américaine, une version Blu-Ray dotée en bonus d’un
commentaire du film d’un ennui total … Par chance, sur de nombreux packages
Blu-Ray, le DVD figure aussi dans le boîtier …
Du même sur ce blog :