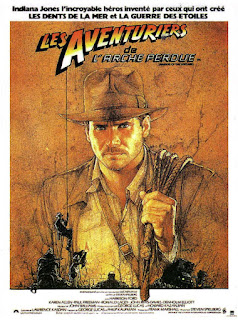Décadence ...
Bon, je vais ramer à contre-courant de l’avis général, parce que beaucoup considèrent que « Satyricon » (le public, venu en nombre le mater dans les salles obscures, et les critiques plutôt élogieuses) est un grand film.
 |
| Fellini sur le tournage |
« Satyricon »
est une (très) libre adaptation du bouquin de Pétrone (Ier siècle). Considéré
comme un des premiers romans occidentaux (mi-prose mi-vers, fragmentaire),
générant beaucoup de controverses littéraires (jusqu’à l’existence même de
Pétrone ou sa vraie identité), ancêtre en même temps des romans picaresques et
des « Caractères » de La Bruyère, il constituait certainement une
source d’inspiration pour les délires baroques de Fellini.
D’ailleurs il s’approprie sinon le bouquin, du moins l’adaptation (le titre italien original du film est « Fellini Satyricon », et en fait un choc visuel. Tourné en grande partie dans les studios Cinecitta, musique de Nino Rotta (pas sa meilleure partition), même si Fellini à l’époque et après l’accueil tiède de « Juliette des esprits », a effectué pas mal de changements dans son entourage technique et sa façon de travailler. L’accroche énigmatique du film (« Rome before Christ, after Fellini », comprenne qui pourra) reprise sur les bandes-annonces d’origine est pour le moins étrange.
L’histoire ?
Bizarrement, il y en a une, ce qui n’était plus toujours le cas chez Fellini
(« Huit et demi », « Juliette … »), et qui le sera de moins
en moins par la suite. « Satyricon » nous conte dans la Rome antique
les aventures d’un trio (deux jeunes éphèbes, un blond et un brun, et de leur
vraie poupée Shein, un jeune garçon dont ils se disputent les faveurs). Déjà,
avec un point de départ comme ça, t’as aujourd’hui une montagne d’assignations
et d’avocats au derrière avant d’avoir pu en placer une pour te défendre. Bon,
« Satyricon » c’est en 69 (année érotique comme l’écrivait Serge et
le chantait Jane), et la société était …euh, (faut faire gaffe à ce que
j’écris, terrain hautement glissant) disons différente.
Les premières scènes nous montrent les deux éphèbes, Encolpe, le blond, et Ascylte, le brun, pas la peine de citer leurs noms ils étaient débutants et inconnus et le sont restés (inconnus) se disputer la propriété de leur petit Giton (le nom commun vient de ce personnage de Pétrone), en se poursuivant dans des catacombes, peuplée par une faune interlope de fracassés physiquement, au milieu de types qui vendent des potions (les petites mains de la DZ Mafia de l’époque ?), et d’autres qui se livrent à toutes les perversions (surtout sexuelles). Toutes ces silhouettes entrevues dans l’ouverture des cryptes, traduisent le sens aigu de Fellini pour caster des « gueules », avec prédilection pour les femmes mûres, peu vêtues et bien enveloppées (mais il n’y a pas que ces silhouettes typiquement felliniennes, il y a aussi les beaucoup plus sexy Capucine, Magali Noel, Lucia Bosè, plus quelques top model de l’époque).
La
partie la plus longue nous montre un banquet chez le riche poète Trimalcion
(c’est aussi le fragment le plus complet du bouquin), où nos trois héros
pervers amenés par un poète fauché (Eumolpe) font figure de blanches colombes
au milieu cette orgie toute en décadence alimentaire et comportementale. Ils
seront ensuite « embauchés » comme galériens (les navires sont très
étranges, de grandes maquettes surréalistes dont il n’est pas certain qu’elles
puissent flotter longtemps) sur un rafiot dont le capitaine tue dans des
combats à mains nues ses rameurs. Va savoir pourquoi, quand viendra le tour
d’Encolpe (ou d’Ascylte, je sais plus), au lieu de se faire occire, il se fera
épouser par le capitaine. Mariage qui durera peu, l’époux finira décapité par
des pirates, le trio échouera dans un grand domaine dont les propriétaires se
sont suicidés après avoir affranchi leurs esclaves, et feront des galipettes
avec une (magnifique) servante noire qui traîne encore là. On les verra plus
tard en compagnie d’un autre larron dont on sait pas d’où il sort kidnapper un
jeune devin hermaphrodite, l’un d’eux affronter un gladiateur minotaure dans un
combat mis en scène par Eumolpe, leur pote poète pauvre devenu très riche.
Toute ces émotions entraîneront une panne profonde de virilité chez Encolpe,
qui ne retrouvera sa vigueur que dans les bras d’une sublime sorcière, avant de
refuser de bouffer le cadavre d’Eumolpe, condition sine qua non pour hériter de
sa fortune. Finalement, les trois tourtereaux embarqueront dans la joie sur un
bateau à l’équipage très « Cage aux folles ».
Faut
quand même convenir que c’est très décousu comme scénario. Et que ce n’est
qu’un prétexte à Fellini pour nous montrer … quoi, au fait ? that is the
question. Et après plusieurs visionnages (à doses homéopathiques, une fois par
décennie au max), j’ai toujours pas compris où le Maître voulait en venir.
Parce
qu’une fois évacué l’aspect visuel, totalement baroque, décadent, surréaliste,
et époustouflant, dont Fellini devenait coutumier, et qu’il convient de ne pas
négliger, parce que « Satyricon » est esthétiquement somptueux, il
reste quoi ? L’impression d’un enchaînement de scènes souvent
incompréhensibles, sans lien être elles hormis la présence des trois jeunots,
et dont le message, si tant est qu’il y en ait un, est passé par pertes et
profits …
Les
plus fins analystes voient dans « Satyricon » une mise en abyme de la
décadence sociétale de la fin des 60’s vue par le prisme de la décadence
romaine post-César-Auguste. Why not, mais ça reviendrait à faire de Fellini un
réactionnaire à la De Villiers et du « c’était mieux avant », sauf
que Fellini, malgré son look de rentier bourgeois n’était ni passéiste ni réac,
ses films d’avant et d’après l’ont montré. Est-on devant une fresque
surréaliste où le visuel (cette galerie de personnages entre les freaks de
Browning peinturlurés et maquillés comme les stars du glam-rock à venir) prime
sur le narratif ? Je pencherai plutôt vers cette hypothèse (la fascination
de Fellini pour les plages, la mer, les monstres marins, les bateaux revient
souvent dans ses films), même si ça suffit pas pour appréhender
« Satyricon ». Est-ce un film sous substances (de persifleuses
rumeurs prétendaient que Fellini tâtait de l’acide lors du tournage de
« Juliette … », lui restait-il quelques buvards ?). Est-ce un
pied de nez à l’industrie cinématographique et sa bien-pensance, en mettant
très en avant homosexualité, libertinage, BDSM, scatologie, et toute cette
sorte de choses, et en s’écartant radicalement de tout ce qui avait précédé et
suivra chez lui ?
J’en
sais rien … regardez « Satyricon » et faites-vous votre avis … si
vous avez deux heures de libres / à perdre (cochez la mention inutile) …