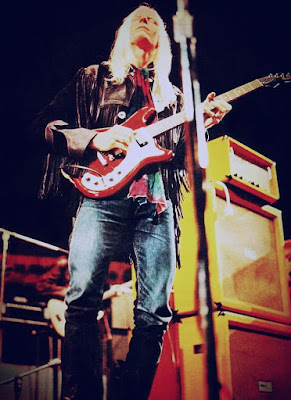Un régal ?
Bof, pas tant que çà … voilà voilà, déjà avec seulement
une poignée de mots, je vais me ramasser une fatwa … Bon, comme je m’en tape
des ayatollahs du blues, je vais continuer sur la lancée …
Commençons par the question essentielle. Des trois King (B.B., Freddie et Albert), lequel est the real King ? Aucun, votre Honneur. Pour moi, les trois vrais Kings, ce sont Muddy Waters (avec une little big help from his friend Willie Dixon), Howlin’ Wolf et John Lee Hooker. Etant entendu que Robert Johnson est tout là-haut, assis à la droite de Dieu (ou plus vraisemblablement du Malin) et hors concours.
B.B. King (B.B. pour Beale Street Blues Boy, raccourci en
Blues Boy, puis réduit à ses initiales, je dis ça pour ceux qui auraient pris
classique ou jazz en première langue), B.B. King pour moi c’est le François
Bayrou du blues. Le type qui est là depuis toujours, qu’on écoute poliment,
mais qui finit par endormir tout son monde avant de s’auto-endormir. Le
bluesman qu’a réussi, toujours tiré à quatre épingles, sa Lucille bien lustrée
(je parle de sa guitare, pour ceux qui avaient pris classique etc …), et avec
lequel tout l’establishment (comme disait le borgne) veut jammer. Parce le gars
King, il est allé sur scène ou en studio avec tous les gens bien établis et
bien propres sur eux : les vieux Stones, U2, of course Clapton, Stevie
Wonder, Ringo Starr, Robert Cray, Etta James, Buddy Guy, John Lee Hooker, Gary
Moore, Albert Collins, j’en passe des dizaines …
Bon, maintenant que les présentations sont faites, venons-en à « Live at The Regal ». Enregistré dans ce club de Chicago (comme tous les autres, B.B. King a effectué la transhumance du Mississippi vers l’Illinois) le 21 novembre 1964. Le B.B. n’en est plus vraiment un, il a quasiment quarante ans, plus de quinze ans de turbin dans le blues, et déjà une ribambelle de titres connus. Le King est un type qui compte dans le blues.
Au Regal, il joue donc à domicile, devant un public
conquis, à entendre les hurlements orgasmiques des nanas (et aussi des mecs)
présents, dont on peut légitimement supposer qu’ils n’ont pas été rajoutés au
mixage. Au vu du tracklisting (deux introductions de la star par deux DJ’s
différents), il est fort possible que comme beaucoup à cette époque, B.B. King donnait plusieurs
concerts par jour (ou par nuit).
Une chose est marquante dans ce disque. La voix et la
guitare de B.B. King sont mixées exagérément en avant (mais vraiment
exagérément). On entend tout juste les types qui l’accompagnent. Ben, c’est lui
la star, il est pas tout seul assis sur un tabouret avec sa gratte, il a un
backing band plutôt copieux. Une rythmique, un pianiste, deux saxes et un
trompettiste. Y’a bien le nom des gars dans la réédition du Cd, mais n’étant
pas un spécialiste de la chose musicale rustique, le blaze de ces types ne me dit
rien. Ce qui ne les empêche pas d’assurer, voire d’être limite envahissants
pour les cuivres. Et le Boss tient la boutique, assure le spectacle, se laisse
aller à quelques effets de manche plutôt faciles mais qui font leur effet sur
un public surexcité. Un public auquel il s’adresse, communique, présente les
titres, et tente de le faire participer autant que faire se peut à la fiesta …
Ça commence sur les chapeaux de roue avec « Everyday I have the blues », rhythm’n’blues up tempo avec force cuivres, et on se dit que ça va envoyer le bois sévère. Ben non, on descend de plusieurs dizaines de bpm (oui, je sais, c’est pas de la techno, pas de remarques désobligeantes) pour aligner un tiercé de blues plus ou moins roots, mais plutôt bien exécutés. Avec mention particulière pour les deux premiers, « Sweet little angel » (un de ses hits, bénéficiant d’un court mais intéressant solo de notes tendues et tenues) et « It’s my own fault » (repris à John Lee Hooker, ce qui oblige le B.B. à sonner roots comme rarement il le fera). « How blue can you get » ne mérite la citation que pour son petit solo de sax tout en retenue jazzy, avant que « Please love me » remette les gaz (titre le plus up tempo du disque) avec un piano rythmique qui louche lui aussi vers le jazz. Tiens, parenthèse à propos des touches jazzy chez les bluesmen live à cette époque. Ça montre qu’ils ouvraient les oreilles sur d’autres genres musicaux et qu’ils en utilisaient quelques gimmicks lorsqu’ils jouaient live (voir le live de Muddy Waters à Newport en 1963 ; que B.B. King a dû écouter, même si lui ne joue pas pour un parterre de bourges blancs qu’il faut pas trop brusquer, on sent l’antre du Regal plus animée et vivante que le gazon de Newport).
Second concert, ou au moins reprise après un entracte et
nouvelle présentation du « king of blues » par un autre DJ. Le
tracklisting de cette seconde partie (seconde face du vinyle d’origine) est à
peu près similaire. On débute avec un morceau assez enlevé « You upset me
baby » du classic rhythm’n’blues. « Worry worry » qui suit
semble en roue libre, avec un solo introductif qu’on qualifiera gentiment de
pré-hendrixien, avant que ça tourne à la démonstration bruyante (il me semble
bien qu’ils ont mixé le King encore plus en avant, c’est souvent pénible, on
dirait que c’est le seul raccordé à la sono. Le final de la rondelle
(trente-cinq minutes, ça va, on peut tenir) semble s’éloigner des sentiers
(re)battus du blues, s’offrant une digression vers du groovy big band (« Woke
up this morning » qui pourrait faire partie du répertoire du Brian Setzer
Orchestra), voire du jazz swing tout mignon (« Help the poor ») en
final, alors qu’au vu de l’ambiance et de l’attente du public, on aurait mérité
quelque chose de plus nerveux. Et pour être totalement exhaustif, l’avant
dernier titre (« You done lost … » est un blues down tempo sur lequel
il n’y a pas lieu de s’extasier outre mesure.
« Live at the Regal », c’est un concert ni
vraiment extraordinaire ni vraiment rebutant. Un live centriste, quoi …