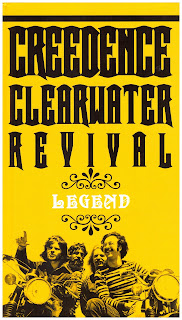MST (Musique Sans Territoire)
C’était un temps (les années 80) où, comme d’habitude la
plupart de ceux qui sortaient des disques en France couraient après ce qui
marchait ailleurs (chez les Grands Britons ou les Ricains). Sauf que par
hasard, à force de courir, certains les avaient dépassés. Oh, pas dans tous les
domaines, mais c’est en territoire mitterrandien qu’était sorti un genre
inconnu ailleurs, qu’on baptisa rock alternatif. Piochant dans les tréfonds de
la musique franchouillarde (les flonflons des bals musette, la chanson réaliste
à texte), et passé à la sauce punk (ou bourrin, ça marche aussi).
Mano Negra 1989
Têtes de gondole du genre, les Bérurier Noir, qui
faisaient ce qu’ils pouvaient pour masquer et refuser un succès populaire
certain, allant jusqu’à la dissolution du groupe pour être sûrs de ne pas
passer en boucle sur NRJ. Dans leur sillage, une foultitude de groupes
affichant à peu près la même radicalité morale. Il y avait deux camps :
les intégr(ist)es, refusant toute forme de « compromission » avec le
« système », et puis ceux pour qui ce qui comptait c’était de
s’éclater entre potes (ceux du groupe, ceux qui venaient les voir). Dans cette
seconde catégorie, la Mano Negra.
La Mano venait de loin. De plein de groupes de
« jeunesse » (Hot Pants, Carayos, Kingsnakes, …), où se sont
rencontrés ceux qui allaient devenir l’ossature de la Mano Negra (les frères
Chao, Santi). Le groupe n’a jamais eu de composition définie et rigide, selon
les époques et les occasions (travail en studio ou prestations scéniques), mais
a toujours compris au moins une demi-douzaine de personnes. Un groupe dont il
n’est pas facile de dresser l’historique au niveau personnel, d’abord parce que
tous avaient un (voire plusieurs pseudos), qu’il y avait beaucoup
« d’invités » (dont certains de façon quasi permanente), et qu’au
hasard de ses tournées dans les pays le plus improbables, des musiciens locaux
se joignaient pour quelques dates (ou quelques mois) au groupe sur scène …
Leur premier album, « Patchanka » est paru chez Boucherie Productions, label de François Hadji-Lazaro (qui avait joué avec Manu Chao dans los Carayos, le monde du rock alternatif est petit …). Le morceau de latino punk endiablé « Mala vida » va devenir un hit, et les majors, sentant le potentiel commercial de la Mano, sa faculté à remplir des salles où le groupe donne des prestations explosives, se pointent avec leur chéquier. La Mano Negra va signer chez Virgin pour un nouvel album, qui sera ce « Puta’s fever » dont je m’en vas vous causer.
Parenthèse : je vais zapper tout le débat
« traîtres – vendus » qui a secoué pendant des années voire plus les
principaux tenants de « l’affaire », les arguments antagonistes et
irréconciliables, les rancœurs étalées au grand jour par presse spécialisée ou
pas interposée, les interventions par centaines de gens qui n’étaient en rien
concernés mais qui prenaient position, et le plus souvent de façon pas très
nuancée … Débats qui n’auraient certainement pas eu lieu si « Puta’s
fever » avait fait un bide …
« Puta’s fever », il ressemble au groupe qui
l’a fait. Protéiforme et bordélique, s’il fallait s’en tenir à deux mots. Il y
a des effluves de rock, de rockabilly, de punk, de reggae, de chanson réaliste,
de rap, de musiques latines, arabes, et j’en passe, le tout souvent mêlé dans
le même titre. Idem pour les paroles, parfois politiques, parfois drolatiques,
parfois nonsensiques … Paroles chantées en français, anglais, espagnol, arabe,
voire entre charabia et yaourt … Et le tout défile à toute blinde (dix-huit
titres en quarante minutes, les plus longs dépassent à peine les trois
minutes).
S’il fallait ne citer qu’un disque similaire, celui qui
s’approche le plus de « Puta’s fever », tant par
« l’esprit » que par la multiplicité des genres abordés, c’est
« Sandinista ! » du Clash (avec quatre faces vinyle de moins).
Parallèle ni très osé ni très difficile à établir, le groupe de Jones et
Strummer est le dénominateur commun d’à peu près tous ceux qui œuvrent dans la
Mano …
Trente cinq ans après les faits, ce stroboscope sonore
passe quand même moins bien que lors de sa sortie. Et malgré les tempos
supersoniques, on trouve des redondances, de l’autocomplaisance, et on sent des
passages « diplomatiques », pour faire plaisir ou mettre en avant tel
ou tel de la bande. Il n’empêche que pour une rondelle aussi
« typée » et datée, « Puta’s fever » tient plus que bien la
route.
Pour une raison primordiale, les gens de la Mano sont
vrais, ne trichent pas, ne renient rien (de leurs origines, de leurs goûts
musicaux, …), ne se la racontent pas, vivent et enregistrent au jour le jour,
sans plan de carrière. Pas de calcul, des tripes et la bonne humeur à faire
partager.
Point musical commun de la plupart des titres, des tempos
tachycardiques. D’entrée le morceau « Mano Negra », un machin speed
indéfini suscite presque le doute (sur vinyle) de la bonne vitesse de rotation
du disque. Et puis le Grand Huit musical se met en branle, on passe du
rockabilly à gros riffs hardos au final (« Rock’n’roll band ») à un
rap, « King Kong Five ». Gros succès en 45T, et fait assez rare pour
un rap somme toute basique, le rythme est souligné par un bon vieil orgue
Hammond (ou c’est bien imité). « Soledad », hormis son tempo
hyper-rapide, pourrait passer pour le meilleur titre des Négresses Vertes, est
soutenu par de gros riffs de cuivres et recrache au final la mélodie de
« Je cherche après Titine » (très vieux morceau franchouillard, déjà
« adapté » en yaourt avec sa chorégraphie surréaliste par Chaplin
dans « Les Temps Modernes »). Suit un morceau chanté en arabe
(« Sidi H Bibi »), mixant musique traditionnelle (?) nord-africaine
et rock alternatif, avant un hommage sonore appuyé au Clash avec « The
rebel spell » et « Peligro ». Changement de décor avec le plus
gros succès du groupe, « Pas assez de toi ». Rythme apaisé mais
festif, sur des paroles bien dépressives, limite suicidaires.
Manu Chao
« Pas assez de toi » est le sommet populaire du
disque. La suite de la rondelle sera moins évidente. Rien d’ignoble, on reste
en terrain connu, mais il y a des choses qui font redite (« Voodoo »,
« Magic dice », « The devil’s call »), on se laisse aller à
la facilité (« Pachuco hop », matrice du punk musette qui engendrera
tant de groupes dispensables), ou à la grosse blague un peu lourdingue
(« Roger Cageot » le titre du guitariste Daniel Jamet, comme un
crobar de Reiser mis en musique, ou « La rançon du succès » classic
rock balourd qui bifurque non moins lourdement sur le « Chéri je
t’aime » du très improbable Bob Azzam).
Au rythme où ça s’enchaîne, on peut pas parler de
remplissage, mais quelques passages auraient mérité d’être élagués, et d’autres
développés sans que ça ressemble à du prog …
Titre charnière du disque : « Guayaquil
City », tempo beaucoup moins oppressant, rythme sud-américain, qui
préfigure la carrière solo de Manu Chao. Parce qu’il faut bien en causer du
garçon. N’allez surtout pas dire que la Mano c’est sa chose, ça lui aurait pas
fait plaisir, d’autant plus que c’est pas vrai. Mais il en était la figure de
proue (guitariste rythmique et principal chanteur), de très loin le plus gros
contributeur en matière d’écriture. Le seul capable de faire parler de lui à la
fin du groupe au début des années 90 en se lançant dans une carrière solo à
l’écho mondial (par charité, on se contentera de citer sans commenter la
reconversion du batteur Santi qui rejoindra le staff directionnel d’Universal
Music et le jury de Popstars sur M6 …).
On ne compte plus tous les groupes et disques qui en
cette fin des 80’s ont surfé sur cette vague patchwork, concrétisée par le
succès de la Mano Negra et de « Puta’s fever ». Très rares ont été
ceux qui sont parvenus à laisser des publications qui tiennent la route
aujourd’hui, autrement que sous l’angle nostalgie … La Mano Negra, c’étaient
les meilleurs et « Puta’s fever » reste d’assez loin leur sommet
créatif …