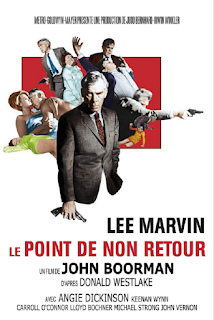Une couleur : rouge ...
« Le sorgho rouge » est le premier film de Zhang Yimou. Et de Gong Li. C’est le film qui les a révélés au monde dit libre (Ours d’Or au festival de Berlin en 1988, ce qui n’est pas une petite récompense). C’est aussi le film qui a annoncé le début d’un renouveau du cinéma chinois, après des décennies de mise en images de la propagande communiste.
 |
| Gong Li, Mo Yan, Jiang Wen, Zhang Yimou |
« Le sorgho rouge » c’est un film qui
comme son pays d’origine, la Chine, cherche « l’ouverture » vers
l’Occident, mais se base sur la tradition et les traditions. La tradition
historique de la Chine (communiste ou pas) et de son meilleur ennemi japonais,
qui a plusieurs fois envahi le continent, d’où la haine séculaire des Chinois
pour le voisin insulaire. L’invasion débutée par le Japon en 1937 sera au cœur
du dernier tiers du film. Les traditions, on les retrouvera pendant des
décennies dans le cinéma asiatique (au sens large, de l’Inde à la Corée, en
passant par la Chine et le Japon), où une grande part des scénarios met
(souvent exagérément) en avant les histoires, contes, légendes, us et coutumes
locales.
Dans « Le sorgho rouge » l’histoire débute en 1929 et se termine dix ans plus tard. Elle est narrée en voix off par le petit fils de l’héroïne (dans la version sous-titrée en français, c’est « grand-mère », en V.O. elle a un nom et un prénom). On ne voit jamais le narrateur. Bon, on s’en passe, il vaut mieux voir Grand-Mère, interprétée par la sublime Gong Li, vingt-deux ans et dont c’est le premier film. Faut préciser qu’être la compagne de Zhang l’a quelque peu aidée à obtenir le premier rôle. Zhang a une quinzaine d’année de plus, et est un directeur de la photo quasiment attitré d’une gloire oubliée et oubliable, un cacique du cinéma de propagande dont j’ai la flemme de rechercher le nom. « Le sorgho rouge » est basé sur deux nouvelles d’un futur Prix Nobel de littérature (en 2012), Mo Yan. C’est au niveau de ces deux sources du scénario que le bât blesse un peu. La transition est abrupte entre les deux parties du film, une paire de personnages secondaires ayant eu des évolutions passées sous silence, quelques intrigues développées dans la première partie sont abandonnées …
 |
| Gong Li |
Gong Li est la neuvième fille d’un couple de paysans
pauvres (pléonasme). Elle est « échangée » contre un âne, pour
devenir la femme d’un riche propriétaire d’une distillerie élaborant une sorte
de gnôle à base de sorgho rouge, dont les champs entourent son domaine.
Problème, l’époux a la cinquantaine et la lèpre … Gong Li est amenée à
l’intérieur d’un palanquin porté par quatre types et suivi par des musiciens du
coin. Ces rustiques, selon la tradition, ne doivent ni la voir, ni l’approcher.
Ils commencent à se lâcher au milieu de paysages arides jaune orangé, se
lancent dans des chants paillards, agitent le palanquin façon space mountain,
et les plus enhardis suggèrent à la jeunette de passer un bon moment avec eux
plutôt qu’avec son futur vieux lépreux. Chemin faisant, au milieu des immenses
plaines de sorgho, le convoi est attaqué par un bandit armé et masqué, que tous
prennent pour Sanpao, terreur légendaire locale. Sauf que ce n’est qu’un
amateur qui sera tabassé à mort par les porteurs du palanquin. L’un d’eux
s’enhardit, allant jusqu’à caresser le pied de la promise.
Qui finalement arrive à la ferme, bien décidée à ne
pas se laisser toucher par le lépreux (elle a planqué une paire de ciseaux de
taille respectable dans ses vêtements). Lequel mari fera pas de vieux os, on le
trouve la nuit suivante assassiné. Les soupçons se portent sur le porteur
entreprenant qui fera vite sa réapparition, d’abord éconduit, avant de finir
par partager le lit de celle qui est devenue la patronne de la distillerie. Un
enfant, le père du narrateur ne tardera pas à venir au monde.
Entre-temps, Gong Li a dû se faire accepter par le
personnel de la ferme, en prendre la direction, et continuer la fabrication de
sa liqueur de sorgho. Elle se sera aussi fait kidnapper par le vrai Sanpao,
sera libérée on ne sait pas trop pourquoi ni comment par son amant, qui ira
défier le bandit dans sa boucherie …
 |
| L'amant (Jiang Wen) |
Contrairement à ce que pourrait penser son synopsis,
« Le sorgho rouge » n’a rien d’un film léger et romantique. C’est un
film âpre, violent. Voire plus, lorsque les Japs entrent en scène (exécutions
sommaires, tortures à base de dépeçage de prisonniers vivants). C’est aussi un
film qui fait passer des messages dans la ligne du parti. Finement, mais bon,
on est deux ans avant Tien An Men, faut faire gaffe. Gong Li, à la tête de la
distillerie, entend gérer différemment (« on partagera les bénéfices »,
argument qui fera rester les hésitants prêts à l’abandonner), elle véhicule
l’image de la femme forte, décidée, chef de file de la rébellion, alors que son
compagnon ne fait que la suivre … Et dépeindre les Japonais aussi cruels ne
peut que plaire au Peuple et à ses dirigeants à casquette et cols Mao …
« Le sorgho rouge » par son scénario et
son traitement, ne serait qu’une fresque « positive » un peu naïve et
violente à la fois. La réalisation de Zhang va faire la différence. « Le
sorgho rouge » est avant tout un choc visuel. Deux couleurs dominent, le
jaune orangé des terres, et le vert des plants de sorgho couchés par le vent.
Et tout en haut du spectre colorimétrique, le rouge écrase tout. Depuis le
début (le palanquin, les habits de Gong Li), jusqu’au final en sursaturation,
où tout est rouge, le sang, l’alcool de sorgho, le coucher de soleil, un rouge
(c’est le but) qui fait se plisser les yeux, lorsque commence à s’inscrire le
générique, on était à la limite du supportable. Pas besoin de son, de
mouvement, cette explosion de rouge saturé se suffit à elle-même … la technique
de Zhang ne se limite pas à une savante manipulation de filtres de couleurs. On
passe de gros plans (amoureux, on pense à Godard filmant Anna Karina) de Gong
Li, à des scènes méticuleusement chorégraphiées (les séquences du palanquin au
début, les rituels et les chants entourant la distillation du sorgho), à des
panoramiques majestueux (des paysages quasi désertiques très Utah Valley, un
coucher de soleil majestueux sur les immenses plaines de sorgho). Pour son
premier film, Zhang prouve qu’il a des choses à dire et à montrer, et qu’il
sait comment s’y prendre caméra au poing pour les dire et les montrer, et fait
preuve d’une maturité artistique certaine.
La reconnaissance critique pour « Le sorgho
rouge » sera mondiale, mais le film est bien trop différent de ceux qui
remplissent les salles pour avoir un quelconque succès public (en gros, le
genre de machin qui sera diffusé à pas d’heure sur Arte). C’est quand il en prendra
le parfait contrepied quelques années plus tard (le huis clos à la place des
grands espaces campagnards), que Zhang signera son chef-d’œuvre (« Epouses
et concubines » toujours avec Gong Li), avant de devenir plus ou moins le
cinéaste mainstream et « officiel » de la Chine …
Du même sur ce blog :
Pas de bande-annonce trouvée, juste un clip de piètre qualité sur Gong Li dans le film