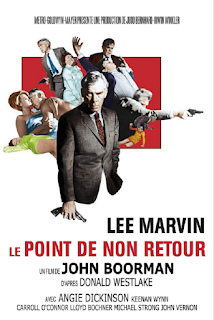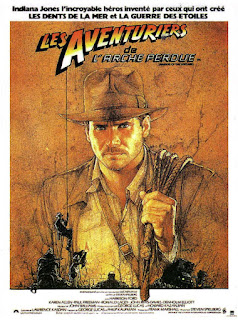Chanson de geste écossaise ...
« Braveheart »
est devenu un classique des films populaires des 90’s. Pas vraiment lors de son
exploitation en salles, où il n’a obtenu que des résultats honorables. C’est
plus tard, lorsqu’on louait des VHS dans les vidéo-clubs, et encore plus tard,
lorsque sont arrivés les Dvds, Blurays, jusqu’à aujourd’hui, avec les
plateformes de streaming, que le vrai grand succès populaire s’est concrétisé
et jamais démenti, appuyé par une critique qui a eu tendance à le réhabiliter,
voire l’encenser.
Faut dire que
le projet « Braveheart » est plutôt audacieux. Confier à un type (Mel
Gibson) qui n’a qu’une seule réalisation à son actif (le mélo à peu près oublié
« L’homme sans visage ») un budget de plusieurs dizaines de millions
de dollars pour un film à grand spectacle, biopic médiéval d’une figure
mi-historique mi-légendaire de l’Ecosse de la fin du XIIIème siècle, ça coulait
pas de source. Même si derrière la caméra, et finalement aussi devant, il y a
un acteur bankable, starisé par les sagas « Mad Max » et « L’arme
fatale ».
Mel Gibson
« Braveheart »
met en images la vie de William Wallace, paysan écossais à l’origine et à la
tête d’une révolte contre l’occupant et oppresseur anglais. Le problème, c’est
que Wallace, on sait peu de choses de lui. Et que Mel Gibson va l’introduire
dans l’Histoire, la vraie, celle qui est documentée. Au prix de quelques
incohérences et anachronismes flagrants, voire de tentatives de réécriture. Le
scénariste (Randall Wallace, ce n’est pas simplement une coïncidence
patronymique, on y reviendra) et Gibson le reconnaissent d’une façon plutôt
badine, prétextant la beauté de l’histoire (du film), tout du long de leurs
commentaires sur l’édition Bluray de 2007.
Premier point
à évoquer, la réalité historique, les faits avérés et documentés. De Wallace,
on suppose qu’il est d’extraction très modeste (paysan ?), qu’avec
quelques comparses il a mené quelques actions de guérilla contre les troupes
« d’occupation » anglaises, avant de fédérer une petite armée de bric
et de broc (quelques nobles et leurs hommes, mais surtout des paysans) qui
défait des Anglais pourtant plus nombreux à Stirlink (1297), avant que les
Ecossais soient laminés l’année suivante à Falkirk. Wallace disparaît de la
circulation quelques années (exil en France apparemment), revient mener
quelques actions coup de poing en Ecosse, est capturé (trahison ?) avant
d’être supplicié (émasculé, écartelé, éviscéré, découpé en morceaux et ses
morceaux « exposés » dans plusieurs villes) en 1305.
La bataille de Stirlink
Robert Bruce
(avec qui Wallace a des relations plutôt compliquées dans le film) sera celui
qui par les armes obtiendra une certaine indépendance de l’Ecosse grâce à sa
victoire à Bannockburn (1314, la dernière scène de « Braveheart »)
Le Roi
d’Angleterre Edouard Ier est considéré comme un des grands souverains anglais,
très politique (plutôt machiavélique donc), et qui instaurera la première
mouture de ce qui deviendra le Parlement. Surnommé (par les Anglais) « The
Hammer of Scottish » par son intransigeance et sa cruauté face aux
tentatives d’émancipation des Ecossais. Il mourra deux ans après Wallace (et
non pas le même jour comme dans le film).
Son fils (le
futur Edouard II) sera connu pour sa bisexualité avérée (nombreux
« mignons » et favoris), et sera beaucoup plus dur et rude que la
lopette qui nous est montrée dans « Braveheart ». Il épousera
Isabelle de France, (Sophie Marceau dans le film) alors âgée d’une douzaine
d’années trois ans après la mort de Wallace. Donc elle et Wallace ne se sont
jamais rencontrés.
Quand aux
autres personnages du film (à part quelques nobles qui ont réellement existé,
mais dont les faits et gestes à l’époque ne sont généralement pas connus), ils
sont tous inventés (Murron sa femme, ses compagnons d’armes, …). Les premiers
récits des aventures de Wallace sont généralement attribués à un troubadour
plus d’un siècle après les faits. Il n’en demeure pas moins que Wallace a de
nombreuses statues un peu partout en Ecosse et qu’il est considéré comme le
premier « libérateur » de son peuple.
Edouard Ier - Patrick McGoohan
Bon, une fois
qu’on a dit ça pour démontrer que « Braveheart » est quasi
intégralement une totale fiction, il en reste quoi de ce film ? Une grande
fresque épique, romantique et violente. D’une durée conséquente. A peine un peu
moins de trois heures, il manque dix minutes de « director’s cut »
apparemment jamais vues, dont l’essentiel est composé du supplice de Wallace
(Gibson dit que c’était très réaliste, trop pour une exploitation grand public
en salles).
Le côté
fresque épique, il est dû au scénariste Randall Wallace. Américain bon teint,
et descendants d’émigrés écossais. Qui décide d’aller faire un voyage
d’agrément familial sur la terre de ses ancêtres. Et tombe sur les statues, les
musées, les lieux « saints » où son homonyme aurait écrit un pan
d’histoire écossaise. Troublé par la coïncidence, le très chrétien Wallace
(Randall) va écrire un scénario et faire de Wallace (William) un personnage
mystique et très croyant (la grande place occupée dans le film par les
funérailles, le mariage « clandestin », les prières avant la
bataille, avant le supplice qui a lieu sur une croix horizontale). Evidemment,
quand la 20th Century Fox le mettra en relation avec Gibson qui cherche un film
à réaliser, le côté grenouille de bénitier va pas laisser le Mel indifférent,
lui qui est catho intégriste (parenthèse, il appartient à un courant religieux
ultra réac, et a fort logiquement soutenu le ticket de demeurés Donald-J.D.,
fin de la parenthèse).
Côté
romantique, ça n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère. Depuis le
chardon offert par la petite Murron au gamin William lors de l’enterrement du
père Wallace occis par les Anglais et conservé comme une relique, jusqu’au bout
de tissu qui les a liés lors de leur mariage et que Wallace serrera dans sa
main pendant son supplice, en passant par les visions de sa dulcinée, n’en
jetez plus … Et l’entrée en « guerre » de Wallace et son obstination
à lutter quoiqu’il advienne contre les « envahisseurs » aura pour
cause l’assassinat de Murron par un petit notable anglais. Sans parler du coup
de foudre réciproque entre Wallace et Isabelle de France …
Sophie Marceau & Mel Gibson
Mais ce qui a
le plus fait jaser, c’est l’ultraviolence limite gore, du film. Les scènes de
bataille sont particulièrement réalistes, ces mêlées-boucherie où tous les
coups sont permis, tuer ou être tué. Les décapitations, amputations, les corps
traversés par les épées, les lances, les haches, les flèches ou les poignards,
les chevaux empalés. Et hors batailles, on a droit aux égorgements, aux têtes
fracassées par les masses d’armes, … A côté, le supplice final de Wallace est
plutôt soft, il n’y a que de la tension liée à l’agonie du roi, aux larmes
d’Isabelle, à l’émotion des compagnons d’armes et de Bruce, grâce à un montage
malin.
« Braveheart »
a renforcé l’aura de Mel Gibson, parce qu’il joue William Wallace, ce qui
n’était pas prévu au départ. Il avoue s’être fait berner par la Fox, qui
alignait sans sourciller les millions de dollars à mesure que le scénario
avançait, mais qui insidieusement suggérait qu’en plus de réaliser il tienne le
rôle principal. Ce qu’il a fini par accepter, sans se douter de l’ampleur de la
tâche. Rétrospectivement, Gibson avoue avoir fini le tournage (sept mois, dont
plus de deux pour tourner les deux batailles, où il fallait gérer
quotidiennement jusqu’à trois mille personnes sur le plateau) à peu près fou,
les neurones cramés par la pression, le manque de sommeil, et le clap de fin
qui n’apparaissait jamais. Il se sentait capable de réaliser, ayant beaucoup
appris en tournant avec George Miller ou Peter Weir, mais il s’est fait bouffer
par son projet, virant obsessionnel pour le moindre détail.
Les anecdotes
sont légion. Pour donner un semblant d’organisation aux batailles, l’équipe a
tourné sur un camp militaire et engagé les bidasses qui y étaient. Et Gibson a
pu mesurer le fossé physique entre des pros qui s’entraînent tous les jours, et
lui, à presque quarante ans (soit dix-quinze ans de plus que son personnage),
qui devait sprinter comme un forcené pour être devant les soldats figurants
lorsque les Ecossais chargeaient l’armée anglaise. En plus, Gibson a réalisé
pratiquement toutes les cascades, sa doublure prévue passait les journées à se
tourner les pouces. Et pour le final (le supplice de Wallace), Gibson a
complètement disjoncté, et contre l’avis de tout son staff, a exigé d’être
réellement pendu (on l’a descendu quand il a perdu connaissance, il a failli y
passer, et rétrospectivement n’est pas très fier de cette décision aberrante).
A côté de ça, l’utilisation d’une énorme vraie hache pour la décapitation fait
figure de plaisanterie (pour le coup, il a quand même pris la précaution de
filmer le geste de bas en haut, et de passer les images obtenues à l’envers au
montage).
This is the end ...
Le résultat
donne un film à grand spectacle (référence de Gibson, « Spartacus »
le péplum plus ou moins réalisé par Kubrick), les plans filmés en hélicoptère
sont nombreux, notamment lors de l’ouverture, avec panoramiques gigantesques
des Highlands. Bien que sachant qu’il tournait une fiction à peu près
intégrale, Gibson a apporté un soin maniaque aux détails, avec un énorme
travail sur la création de décors en extérieur, les costumes et les
maquillages. Le vice a été poussé jusqu’à rechercher parmi les agriculteurs
écossais ceux qui pouvaient fournir des races centenaires de bovidés juste pour
une scène, lorsqu’on ramène les dépouilles du père et du frère de Wallace morts
au combat. Hormis les deux grandes batailles, tournées dans une base militaire
irlandaise, les extérieurs sont en Ecosse, sous la pluie (invisible à l’écran,
quand on la voit, c’est que de l’eau est versée à seaux sur le plateau) et le
froid la plupart du temps. Quasiment aucun effet numérique n’a été rajouté, un
encadrement médical, vétérinaire et de dresseurs était présent en nombre, aucun
cheval n’a bien évidemment été abattu ou blessé (ceux qui sont empalés sont des
chevaux mécaniques, trucage à l’ancienne), et parmi les centaines de figurants
des scènes de bataille, Gibson est fier de préciser que seuls trois blessés ont
été recensés, deux contusionnés et une fracture de la cheville en tout et pour
tout …
La musique
est dans l’air celtique du temps, et le thème principal est l’œuvre de James
Horner qui en utilisera une version dérivée pour le thème de
« Titanic » qu’il composera deux ans plus tard …
Un mot sur Sophie
Marceau, principal rôle féminin en (future) reine glamour mais déterminée, elle
entamera avec « Braveheart » un lustre de tentative de carrière
internationale, qui malgré un autre succès remarqué au box office (le rôle de
la méchante dans « Le monde ne suffit pas » de la saga James Bond),
n’ira pas plus loin que la fin des années 90.
Alors au
final, il faut en penser quoi ? « Braveheart » est un film
d’action survitaminé et palpitant, et une incontestable réussite visuelle. Le
seul reproche, les libertés prises avec la réalité historique qui enjolivent
quelque peu (pour être gentil) ce biopic de William Wallace. Les Ecossais ont
adoré le film, les Anglais moins …