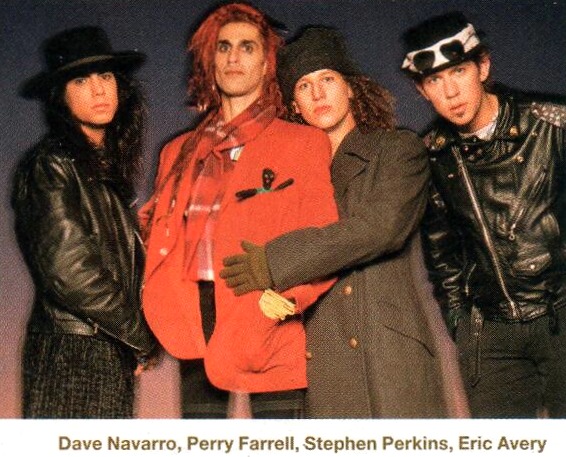Computer blues ...
Alors là, attention chef-d’œuvre … c’est ce que vous
diront avec des trémolos dans la voix tous les maniaco-dépressifs, et tous ceux
qui n’écoutent que de mauvais disques.
Non, non, mes petits chéris, il n’y a pas de quoi se
relever la nuit. Tout au plus je serai d’accord avec vous pour dire que c’est
un disque intéressant, le meilleur des tristos Radiohead. Des types pourtant
prometteurs, dont j’attends encore qu’ils sortent un bon disque. Qui ne viendra
jamais, ils sont maintenant trop vieux, trop rances, trop perdus dans leur cérébralité
neurasthénique …
« OK Computer » est un disque qui n’eut
pas grand mal à surnager dans cette seconde moitié des années 90, à la qualité
musicale en chute libre (on avait commencé avec Nirvana et fini avec Mumuse,
c’est dire l’ampleur des dégâts) et globalement très affligeante. « OK
Computer » est un ramassis assez bien torché de tout ce qui pouvait
« fédérer » la génération désenchantée comme disait l’autre. Des
choses, des sons, des structures de titres déjà entendus mille fois chez
d’autres, vaguement ripolinés d’une humeur morose et d’un pathos geignard. Et
comme point de ralliement, la voix sous Prozac pleurnicharde de Thom Yorke. Que
je ne supporte pas, il y peut rien et moi non plus …
Musicalement, ça tient globalement assez bien la
route. « OK Computer » sera certainement le dernier grand disque
conçu pour les chaînes hi-fi, avant que l’hyper compression pour mp3 et iPod
lamine tout. Les Radiohead et leur producteur Nigel Godrich, de fait le sixième
membre du groupe, ont effectué un travail considérable et le plus souvent
réussi sur la structure sonore. « OK Computer » est un disque qui
s’écoute, qui ne se subit pas. Avec suffisamment de prise de risques pour se
démarquer du troupeau indie-rock dans lequel s’ébrouait jusque-là le groupe.
On a souvent qualifié ce disque de
« floydien ». Ouais, si on veut, quand bien même « Subterranean
homesick Alien » doit autant à Dylan par son titre qu’aux disques solo de
Roger Waters des 80’s. Comparaison plus pertinente quand il s’agit des
brouillages radios de l’intermède « Fitter happier » et surtout du
très « Echoes » « The Tourist ». Rayon seventies,
« Lucky » me semble inspiré par le « Red » de King Crimson,
même s’il est juste pleurnichard quand le disque de la chose à Fripp suintait
le tragique et le désespéré. Les deux titres les plus révérés m’ont toujours
gavé, que ce soit le patchwork « Paranoid android » (du folk, du
bruitisme, du chant grégorien, etc, etc …, me fait penser au fuckin’ prog ce
machin …), et la ballade qui s’énerve sur la fin comme il y en a des milliards
de « Karma Police ». J’ai aussi beaucoup de mal avec cette sorte de
heavy metal qu’est « Electioneering », et avec la bouillasse
free-rock sans intérêt de « Climbing up the walls ».
Le reste, je suis preneur. Avec mention particulière
pour « No surprises » la comptine mélodique simple mais efficace,
« Exit music for a film », qui réveille le fantôme de l’excellent
Jeff Buckley, pour une fois bien chantée (comme quoi il en est capable, mais
pourquoi diable alors ces sempiternels funestes gémissements ?) par Yorke,
et la pop-rock de « Let down », sorte de « Ruby Tuesday »
des années 90.
Au vu et surtout à l’entendu de ce qu’ils ont fait
par la suite (curieusement, j’ai toujours apprécié un de leurs plus ignorés, le
politisé « Hail to the thief »), il semble aussi que les Radiohead
aient voulu conclure avec « OK Computer » un cycle de leur carrière,
s’acheminant de façon de plus en plus kamikaze vers l’électronique envisagée
par eux de façon quasi lugubre. Rien que pour ça, ce pied de nez à tous les
schémas de rentabilité immédiate, ils auront gagné ma miséricorde …
Des mêmes sur ce blog :
In Rainbows
Des mêmes sur ce blog :
In Rainbows