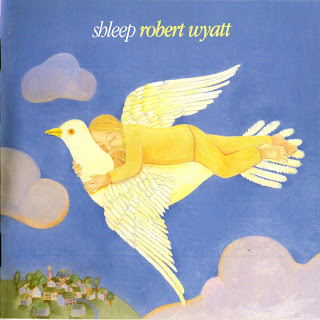Intouchable ...
Et Robert Wyatt, s’il est dans un fauteuil à
roulettes, c’est pas pour tourner une comédie pleine de bons sentiments
téléthonesques. Et même s’il a un solide sens de l’humour absurde, c’est pas
marrant tous les jours …
Lui le batteur-star des par ailleurs vite devenus
pénibles Soft Machine (et encore plus pénibles une fois qu’il les a eu largués
au bout de trois disques) qui un soir de biture a confondu porte et fenêtre
d’un troisième étage et s’est retrouvé avec les jambes bétonnées pour le
restant de sa vie. Y’a des jours, et surtout des nuits, quand bien même compte
t-il les moutons, il ne peut pas dormir … d’où le titre de ce disque.
Donc « Shleep » est une œuvre inspirée par
l’insomnie et la souffrance morale. Je reconnais que présenté comme de la
sorte, ça plombe un peu l’ambiance. Bon, fuyez pas tous. Parce que là,
attention grande œuvre, voire chef-d’œuvre. Et une musique pas déprimante pour
deux sous … Il y a même des fois où l’on se croirait face à des inédits de
« Rock bottom », cet OVNI sonore qui avait illuminé de sa classe
l’assez pénible milieu des seventies. Particulièrement flagrant sur un titre
comme « Was a friend », où l’on retrouve tout ce qui ce qui a fait le
génie de Wyatt en 1974 : les synthés mélancoliques, la trompette
plaintive, la voix aiguë et fluette … Faut dire que l’infirme a un joli carnet
d’adresses de fans que l’on retrouve sur la plupart des titres (Brian Eno, et
pas seulement comme co-producteur), ou sur quelques-uns (l’ex Roxy Music
Manzanera, l’ancien Jam Paul Weller, le jazzeux Philip Catherine, …). Sans
oublier évidemment sa compagne-muse Alfreda Benge (« Alfie » pour les
intimes et ceux qui en seraient restés à « Rock bottom »),
responsable comme souvent de la jolie pochette naïve de « Shleep ».
Derrrière son éternel look de Raspoutine au regard
malicieux, Wyatt est un poète. Et il n’a pas besoin de mots, avec des
instruments de musique il y arrive, voir la comptine bouillonnante
« Maryan », le concassage sonore de « The duchess » qui
renvoie tous les « déstructurateurs » de musique à leurs chères
études, « Free will and testament », titre lyrique au feeling
ahurissant, et après lequel les pompiers Arcade Fire passeront toute leur
existence à courir sans jamais rattraper ce niveau, l’inaugural « Heaps of
sheeps », on dirait au début du Blondie ou du Talking Heads, avant que la
voix de Wyatt propulse ce titre dans une stratosphère où bien peu ont réussi à
aller. Et parce que Wyatt est fan de jazz et de classique (nobody’s perfect)
« September the ninth » est
tout imprégné des funestes musiques, et ça ressemble à ce que les ridicules
progueux devraient faire depuis quatre décennies, s’ils avaient une once de bon
goût musical. Et puis, au cas ou un fan d’electro passerait par là le spatial
et monstrueux « Alien » superpose synthés et boîtes à rythmes, et on
a envie de suggérer aux joueurs de disquettes qu’ils prennent de la graine de
ces schémas-là, leur bousin en serait moins pénible … Devant par la force des
choses se contenter de donner le rythme par des percussions, Wyatt abuse
parfois des claviers (piano et synthés), et quand il les combine à sa trompette
lugubre (qui d’accessoire rigolo à ses débuts est devenue, infirmité oblige,
très importante dans sa palette sonore), ça donne un truc bien plombant
(« Out of season »), heureusement isolé dans ce disque et de moins de
trois minutes, ça va on supporte.
C’est ça aussi la magie des disques de Wyatt, ce ne
sont pas des œuvres sombres d’infirme qui cherche la compassion ou le
réconfort, ça respire quelles qu’en soient les motivations la joie et l’envie
de vivre, sans pour autant sonner comme la Compagnie créole ou des chansons à
boire. Il y a une humanité, une subtilité et une finesse toujours présentes (ce
qui n’est pas toujours le cas de sa production discographique, peu sont aussi
réussis que « Shleep »). A la fin du disque, il y a même un hommage
(tongue-in-cheek, comme souvent avec Wyatt) à Bob Dylan (« Blues in Bob
minor ») qui comme le « Song for Bob Dylan » de Bowie n’a pas
grand-chose à voir musicalement avec le barde de Duluth, même si ça fait
parfois penser (la diction gaguesque de Wyatt sur ce titre), à la période
« Highway 61 – Blonde on blonde » ; c’est le titre le plus
direct, le plus rock du disque, le seul où les guitares sont mises en avant.
Wyatt est assez rare discographiquement, et pas
souvent à ce niveau. Avec l’insubmersible et indépassable « Rock
bottom », « Shleep » fait pour moi partie de ses pièces
maîtresses.
Du même sur ce blog :
Rock Bottom
Du même sur ce blog :
Rock Bottom