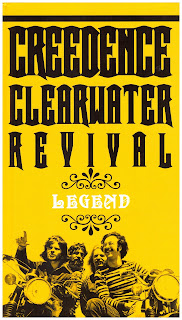Essentiel ?
Il est assez étonnant de voir que Creedence, qui fut
pendant quelques années (et pas n’importe lesquelles, celles de la fin des
années 60 où il y avait quand même encombrement de talents) le roi
incontesté des charts américains, est aujourd’hui à peu près complètement oublié.
Il serait temps que le peuple se mobilise pour réhabiliter Fogerty et sa troupe.
La réhabilitation de Creedence, voilà une revendication qui aurait de la
gueule. N’est-ce pas les gilets jaunes, si tant est qu’il y en ait quelques-uns
parmi vous qui sachent lire et formuler une doléance cohérente (le régime merguez-Heineken à fortes doses montre vite ses limites quand il faut utiliser son QI), voilà une revendication
autrement plus importante que le prix du carburant, le pouvoir d’achat, ou la
démission de Macron (vous voyez qui c’est lui, le quadra aux poses messianiques
à la Don Camillo, et qui vous a fait croire qu’il allait mettre notre pays en
marche, alors qu’il est juste encore plus nul et arrogant que Mr Gayet et Sarko réunis, ce
qui n’est pas peu de chose, et qu’il est accompagné par une bande de têtes de nœuds
genre Le Maire, Darmanin, Grivaux, Castaner, liste loin d'être exhaustive, qui devraient repartir au plus vite d’où ils
viennent, la troisième division de la droite centriste et de la gauche molle, et arrêter de se prendre pour des hommes politiques, eux à qui on ne voulait même pas confier le nettoyage des latrines au siège de leurs anciens partis respectifs) ?
… La France va mal, camarades ( ? ), raison de plus pour écouter Creedence
… qui eux n’ont jamais fait de politique (quoi que, on y reviendra si j’y pense),
mais qui étaient à peu près aussi mal habillés qu’un Breton mécontent et bourré
(pléonasme) en bonnet rouge et / ou gilet jaune…
Remarquez, sans les chemises de bûcheron à carreaux,
avec quoi auraient bien pu se fringuer Neil Young, Bruce Springsteen et Kurt
Cobain ?
 |
| John Fogerty, Tom Fogerty, Doug Clifford, Stu Cook |
Creedence, c’était la revanche des ploucs sur les
types (et les nanas) dans l’air du temps. Ils étaient pourtant au bon endroit
(la Californie, du côté de San Francisco) au bon moment (le milieu des années
60). Comme l’Airplane, Quicksilver, Grateful Dead. Sauf qu’ils n’ont pas
cherché à inventer un langage musical sous LSD. Et qu’ils ont peut-être jamais foutu
les pieds à Haight Ashbury, se contentant de leur morne El Cerrito (banlieue
nord-est de Frisco, de l’autre côté de la Baie).
John Fogerty aime le rock’n’roll des origines, Presley
et consorts. Son pote de lycée, Doug Clifford, pareil. Tous les deux rêvent de
faire de la musique, sans ambition, juste un college band. L’affaire s’emmanche
quand John se fait offrir par ses parents une Silvertone pourrie d’occase et
que Doug se bricole une batterie à base de pots de fleurs. N’ayant pas eu l’idée
de s’appeler les White Stripes ou les Black Keys, il leur faut du renfort. Ce sera
Stu Cook (parce qu’il est dans la classe de Clifford, et quand on les fait s’aligner
par ordre alphabétique, ils se retrouvent à côté). Cook est pianiste (enfin il
sait vaguement jouer du piano). L’aventure en trio commence, sous des noms totalement
improbables qui ne tiennent que le temps de dégoter un concert où ils jouent
(des reprises) dans l’indifférence générale.
 |
| Version trio |
Les minots sont motivés, et finissent par être
reconnus (dans leur pâté de maisons et leur lycée). Entre-temps, Cook est passé
à la basse. Il est temps de faire un gros coup. John propose à son frère aîné
Tom de les rejoindre. Tom, c’est la star des Fogerty. Il compose, joue de la
guitare en faisant des solos et chante dans un groupe « célèbre ».
Quelquefois même dans des bars ou des clubs à pfff … des quinze ou vingt
kilomètres d’El Cerrito. Sur la seule renommée de Tom, le quatuor « explose »,
sous le nom de Tommy Fogerty & The Blue Velvets. Il quitte le lycée d’El
Cerrito pour jouer dans les mêmes rades que fréquentait Tom. Pour les trois
pieds-nickelés originels, c’est le jackpot artistique. Ils enregistrent même une
paire de 45 T sans aucun succès. Mais à force de s’acharner, les quatre zozos
voient leur audience s’accroître, et finissent par décrocher des contrats pour
des concerts devant des dizaines de personnes. Et là surgit l’accident
industriel. Tom, incontesté chanteur guitariste et leader est bouffé par le
trac dès lors que l'assistance est composée d’autres personnes que ses copains.
John commence donc à chanter et à prendre les solos. Et tant qu’à faire comme c’est
lui qui va les chanter, à composer les titres de leur répertoire. Une sono asthmatique
l’oblige à s’égosiller au micro, ce qui donnera ce chant forcé immédiatement
reconnaissable.
Tout passe, et même l’adolescence. Faut bosser,
faire l’armée tout ça … Le groupe (qui a encore changé de nom après que ses 45T
se soient vautrés) est mis en sourdine. John glandouille chez Fantasy Records,
micro label orienté jazzy, qui récupère par hasard un hit (au niveau de la Californie)
et un peu de fric. John suggère au patron de Fantasy de signer son groupe, qui,
c’est pas lui qui choisit, s’appelera les Visons. Puis les Golliwogs. Des 45 T
suivent avec les bides habituels. Le patron de Fantasy vend en 1967 sa boîte à
un de ses employés, Saul Zaentz. Qui hérite donc des Golliwogs. Qu’il somme de
se rebaptiser en optant pour un nom à la Quicksilver Messenger Service, qui
commence à se faire un nom à San Francisco. Les trois mots choisis seront Revival
(l’ambition de remettre le rock’n’roll au goût du jour), Clearwater (la pureté,
la nature, les utopies hippies, …) et Creedence parce que Tom a un pote qui se
prénomme comme ça et que ça le botte un nom de baptême pareil …
Parenthèse : John Fogerty voue depuis des décennies
une haine féroce et tenace vis-à-vis de Saul Zaentz (l’humiliant même dans une
chanson et son clip plein de cochons « Zanz Kant Danz » sur son disque
solo « Centerfield » en 85). Il s’est peut-être (sûrement ?)
fait escroquer par un contrat tordu, mais sans Zaentz, point de Creedence,
parce que fallait y croire ou être un sacré visionnaire pour signer cette bande
de péquenots et leur drôle de musique ringarde en 67. Fin de la parenthèse …
 |
| Creedence live |
Et là, tout à coup, ça fonctionne. Le premier single
(« Porterville ») est remarqué, le second (« Suzie Q ») est
un succès. Creedence sera un groupe à singles. Des singles rustiques, pleins à
la gueule de ce rock’n’roll fifties, avec des touches de country ou de blues. Pendant
quatre ans, de 68 à 71, tous leurs singles finiront en haut des charts
américains, beaucoup plus rarement ailleurs. Creedence est un groupe de pécores,
de traditionalistes, qui portent haut l’étendard du « c’était mieux avant ».
John Fogerty est capable en deux minutes trente de choses fulgurantes, d’une
simplicité et d’une évidence bibliques (« Bad moon rising », « Fortunate
son », « Travelin’ band »). Mais
aussi des ballades définitives (« Who’ll stop the rain », « Have
you ever seen the rain »). Sa voix forcée peut lui permettre de reprendre Little Richard sans se
couvrir de ridicule (« Good Golly Miss Molly »), tout comme McCartney
ou Wanda Jackson (liste close). Il sait se fendre de quelques solos de guitare « acide »
dans l’air hippy du temps, sans prétention, mais sans se ridiculiser. Les
albums (en gros un tous les huit mois) cartonnent …
Chaque médaille ayant son revers, CCR a sa dark
side. Le Tom, de star du groupe lors de ses dures années originelles, est un
faire-valoir, un comparse de John qui lui focalise regards et louanges. Le bond
frisé va très mal vivre cette situation, les rapports avec les autres et
surtout son frangin seront vite détestables et il quittera le navire après l’enregistrement
de « Cosmo’s Factory ». Et puis, les albums de Creedence sont
inégaux. Même s’ils contiennent toujours les singles. Parce que Fogerty a la fâcheuse
habitude d’étirer des titres au-delà du raisonnable, dans des jams bluesy cotonneuses,
à faire passer les frères Allman pour des types concis et Canned Heat pour un
groupe plein d’imagination. Tous leurs meilleurs disques (les cinq premiers) comptent
en leur sein ces pénibles « Suzie Q pt I & II », « Graveyard
train », « Keep on chooglin’ », « Ramble tamble », « I
heard it to the grapevine ». De leur discographie, « Cosmo’s factory »
est toujours cité comme leur apogée. Désolé, mais avec « I heard it … »
et « Ramble tamble », soit vingt minutes et donc la moitié du disque,
z’êtes sûr ? « Cosmo’s … » est très daté et commence à perdre de
cette dynamique, de cette fougue qui faisaient tout le succès et le son
Creedence des singles. Perso, je trouve celui d’avant, « Willie & the
poor boys » infiniment meilleur, c’est le plus roots, aucun titre
au-dessus des six fatidiques minutes.
 |
| John Fogerty |
Venons-en à « Legend » donc. Un coffret de
trois rondelles sorti au milieu des années 90. Réédité par Warner Jazz ( ? !
) France en 2002. Remastérisé pour l’occasion en 24 bits, et avec un bon livret
bilingue (une page en français, en face la version anglaise), dans lequel j’ai
pioché les infos biblio du dessus. Rien à dire, bel objet. D’autant plus que
comme Creedence n’a sorti que sept albums studio (plus un live très dispensable),
les six premiers sont dans l’ordre chronologique sur le coffret plus les trois
singles (plutôt corrects) issus de leur chant du cygne, le plutôt mauvais « Mardi-Gras ».
Pas une intégrale studio, mais pas loin. D’autant que (voir les rééditions avec
bonus des albums pris séparément), il semble bien qu’il n’y ait que peu de
matériel studio inédit chez Creedence (faut dire qu’à la vitesse où ils
paraissaient, ça laissait pas trop de temps aux fioritures et aux
expérimentations).
On peut donc mesurer l’évolution du Creedence sound
(un peu fouillis aux débuts, genre swamp-rock), celui-ci culminant à mon sens
sur « Green river » (le troisième, le plus rêche, avec Fogerty qui ne
chantera plus jamais aussi sauvage). Ensuite, très discrets sur « Cosmo’s … »,
les instruments additionnels au strict deux guitares basse batterie des débuts
viendront encombrer le paysage sonore (claviers, cuivres façon revue Stax sur « Pendulum »).
C’est joli, bien fait, « surproduit » par rapport aux débuts, mais la
magie et la hargne de la jeunesse sont partis …
Creedence a vécu un peu en marge de la musique
dominante américaine (apparition – quelconque – du groupe à Woodstock étant l’exception
qui confirme la règle), mais en sachant garder les pieds sur Terre. Trois chansons,
et pas des moindres (« Fortunate son », « Who’ll stop the rain »,
« Have you ever seen the rain ») font référence au conflit du Vietnam
et valent bien dans l’esprit les pamphlets de Country Joe ou le « Machine
gun » d’Hendrix et de sa bande de gypsys.
Fogerty, s’il a pas mal visité les autres, est un
grand auteur. Et une marque de fabrique américaine, purement américaine. Sans
doute que sans lui, les carrières de Bob Seger ou Springsteen n’auraient pas
été les mêmes, pour parler des plus évidents. Fogerty a pas mal repris, mais a
laissé quelques bornes de la musique populaire américaine difficilement
contournables. Deux exemples suffisent. Tina (et Ike) Turner ont boosté leur
carrière lorsque Tina s’est mis à reprendre de façon fellatoire (le sort qu’elle
faisait au micro, avec les Ikettes poussant à l’orgasme aux chœurs) « Proud
Mary » (pourtant une histoire toute con d’un bateau avec roues à aubes qui
descend un fleuve), et la seule « Run through the jungle » (déjà un
titre un peu à part dans le répertoire de Creedence) reprise par le Gun Club a
généré tous les les groupes de rock « torturés » des années 80 (Noir Désir
par ici) … Sans parler du « Fortunate son » adapté par Labro pour feu
Hallyday …
Creedence était, en dehors de son trajet interne, de
toutes façon condamné. Un clone bruyant et bourrin (Grand Funk Railroad, un nom
en trois mots, tiens tiens …) le remplaçait en haut des charts à grands coups d’hymnes
démagos et simplets. Et de toute façon Led Zeppelin mettait aux States tout le
monde d’accord …
Creedence est un groupe essentiel. Dont les albums
pris un à un le sont moins …