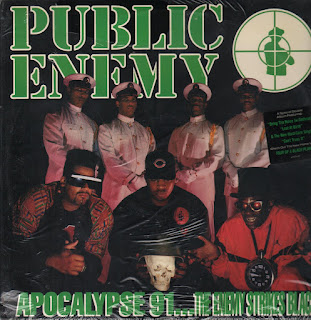Great disco swindle ...
« La fièvre du Samedi soir » (« Saturday night fever » en V.O.) est le genre de films comme il peut en sortir deux ou trois tous les cinquante ans. Pas de scénario, des acteurs au mieux de quinzième zone, un budget de misère, un inconnu à la caméra, et résultat, un film que même les talibans doivent connaître … Comment peut-on en arriver là ? Asseyez-vous, sortez les costards blancs, les chemises à cols pelle à tarte, les chaussures vernies à talons compensés, allumez les boules à facettes, mettez à portée de main une compile de Kool & The Gang, et ouvrez grand vos oreilles, Papy Lester va vous conter cette histoire peu commune …
 |
| Badham & Travolta |
A l’origine de toute l’affaire,
Nik Cohn. Anglais expatrié aux States, et une des stars du journalisme « rock »
des seventies, auteur de l’excellent « Awopbopaloobop alopbamboom, the golden
age of rock ». Toute la presse spécialisée ou pas lui demande des articles
sur les nouvelles tendances musicales. En 1975, il écrit un papier fleuve pour
le New York Magazine intitulé « Inside the Tribal Rites of the New
Saturday Night », racontant son immersion dans des clubs interlopes de la
ville où toutes les communautés sociales et raciales de New York se réunissent à
la fin de la semaine de boulot au son des rythmes disco. Cohn l’a depuis avoué,
son article est totalement bidon, il a tout inventé, ces endroits au pire n’existent
pas, et au mieux, il ne s’y passe pas vraiment ce qu’il décrit … Bon le disco lui
existe, extrapolé du funk et de la soul (notamment de Philadelphie) un rythme
dansant en 4/4 avec les seconds et quatrième temps très appuyés (le fameux tchac-poum).
Mais c’est une musique pas très populaire, et surtout uniquement réservée au
public Noir. Ses « héros » en 1975 sont Barry White, KC & the
Sunshine Band, Gloria Gaynor, vont apparaître Donna Summer et Chic (à noter que
le « Young americans » de Bowie s’inspirait en partie de ces rythmes
avant-gardistes). Cette vague disco qui grandit va évidemment générer ses
détracteurs (le fameux slogan « Disco sucks » et à la fin de la
décennie les autodafés des 33T de disco).
L’article de Nik Cohn, des gens l’ont lu. Dont Robert Stigwood, producteur entre autres de films musicaux « contre-culturels » genre « Jésus-Christ Superstar » ou la nanardesque version filmée de « Tommy ». Stigwood vient de prendre sous son aile (moyennant un contrat léonin) un réalisateur de seconde zone, John Avildsen. Qui vient de terminer « Rocky », un film évidemment fauché sur le rêve américain à travers le prisme de la boxe, donnant la vedette à un nabot italo-américain quasiment inconnu, Sylvester Stallone. Avildsen est sommé par Stigwood de mettre en chantier et à moindre frais un film sur le disco. Manière de refaire le coup de Stallone (« Rocky » vient de sortir et grimpe au box-office), la tête d’affiche sera confiée à un certain John Travolta, acteur localement connu pour son rôle dans une série télé diffusée sur New-York … Mais Stigwood n’est pas que dans le cinéma, il est aussi dans la musique et s’est occupé notamment de la carrière de Cream et a en magasin un groupe de frangins originaire de son pays (l’Australie), les Bee Gees. Un groupe a la trajectoire bizarre, ayant commencé en Angleterre par des chansons psychédéliques, avant de tomber dans l’oubli, de revenir avec de la pop plus ou moins symphonique et des hits mondiaux (« Massassuchets », « To love somebody ») et de retomber de nouveau dans l’anonymat. Là, vers 1975, ils tentent de bricoler des morceaux sur des rythmes disco. Le requin Stigwood sent le coup double, produire un film sur le disco, et en confier la musique aux frangins Gibb, chargés d’écrire des titres pour la B.O, et de faire le tri dans tout ce qui est proposé par d’autres (y compris d’improbables reprises de la Vème Symphonie de Beethoven ou une extrapolation d’un thème de Moussorgski, ces deux titres finiront sur la bande-son du film). Comme Stigwood est dans la musique, il sent bien que la vaguelette disco peut vite faire flop, et met la pression sur Avildsen (scénario, repérages, casting, …) pour qu’il accélère la cadence. Pendant que de son côté Travolta suit depuis des mois des cadences de travail infernales avec un chorégraphe, perd des kilos, et se demande si ce film sera réellement mis en chantier.
Les choses traînent et Stigwood
ne va pas faire dans le détail. Il convoque un jour Avildsen (c’est Avildsen lui-même
qui raconte dans les bonus de « Saturday night fever ») en lui disant :
« J’ai deux nouvelles pour toi. Une bonne et une mauvaise. La bonne, c’est
que « Rocky » est nominé plusieurs fois aux Oscars. La mauvaise, c’est
que je te vire. ». Exit Avildsen et recrutement immédiat d’un quasi
anonyme, John Badham. Avec un ordre de mission clair et concis, en gros : « Tu
as trois mois pour tourner un film sur le disco avec Travolta en tête d’affiche.
Et une poignée de dollars. Allez, action … ».
« La fièvre du samedi soir » sera donc tourné en extérieurs dans Brooklyn, une minable boîte locale sera relooké, et un certain Norman Wexler chargé d’écrire un scénario à partir de l’article de Nik Cohn … Inutile de dire que tout sera fait à l’arrache, Travolta ayant même à peu près carte blanche pour improviser ce qui n’est pas écrit (dans toutes les scènes, de danse ou pas) … Sauf que très vite les problèmes vont se multiplier. L’inconnue chargée du premier rôle féminin jette l’éponge (ou est virée selon les versions), et la tout autant anonyme Karen Lynn Gorney est recrutée la veille du premier jour de tournage. Au bout de quelques prises, il s’avère que tourner en extérieurs à Brooklyn n’est pas une bonne idée, c’est à peu près le seul endroit au monde où Travolta est connu, et très vite des dizaines, des centaines de badauds (ils disent des milliers dans les bonus du film, j’ai l’impression qu’ils exagèrent) vont arriver sur les lieux du tournage pour voir le héros aminci et relooké de leur sitcom favorite. La police en nombre devra les contenir, généralement sur le trottoir d’en face. Corollaire, la mafia locale, guère séduite par autant de gens et de flics sur son carré de bitume, va venir demander à Stigwood une petite contribution financière, afin de « sécuriser » les lieux de tournage. Ignorées dans un premier temps, ces demandes seront acceptées après le départ tout à fait accidentel de quelques incendies (notamment devant la boîte où se passe une grande partie du film). Mais le pire n’est pas là. Travolta sur qui repose tout le film perd au début du tournage sa femme de dix-huit ans son aînée, emportée par un cancer du sein. Il lui faudra composer avec le deuil et la douleur et assurer devant la caméra … une légende est en train de s’écrire …
 |
| Travolta & Gorney |
Badham tiendra le cahier des
charges, et les premières diffusions du film ont lieu fin 1977. Résultat :
un film qui a coûté trois millions et demi de dollars en a rapporté quasi 70
fois plus lors de son exploitation en salles (sans compter les VHS, les
locations, Dvd, Blu-ray, ou les ressorties en salles). La bande-son du film s’est
dépotée à 40 millions d’exemplaires dans le monde, avec trois titres des Bee
Gees (« Stayin’ alive », « How deep is your love » et « Night
fever ») en haut des charts mondiaux en 1978. Il paraît que celles de « Bodyguard »
et « Dirty dancing » ont fait mieux à quelques unités près. Sauf que
ces deux dernières étaient des vinyles (ou Cds) simples, celle de « Saturday
night fever » est un double vinyle (ou Cd).
Comment tel raz-de-marée commercial est-il possible ? Parce que contre toute attente « La fièvre du samedi soir » est un film, un vrai de vrai. Avec une histoire, des personnages pas toujours très simples-simplistes-simplets, une énorme performance de Travolta (qui est de toutes les scènes) … Et puis une conjonction étonnante avec l’actualité. La vague disco aurait pu avoir disparu lors de la sortie du film. Elle était en train de submerger le monde, tous les clubs, toutes les radios, tous les juke-boxes crachaient du disco. A quelques encablures du lieu de tournage le Studio 54 devenait la boîte la plus branchée du monde, Bianca Jagger en était son égérie (et principale cliente), son Mick de mari y passait quelques fois, et toutes les stars et milliardaires du monde s’y faisaient photographier. Et c’était une boîte à la programmation 100% disco … Rarement film a été autant raccord avec l’actualité qu’il traite (le seul autre exemple qui me vienne à l’esprit, c’est « Le dictateur » de Chaplin). Et ça attirait du monde parce qu’on voyait et entendait (en plus du chant et de la danse) dans « La fièvre du samedi soir » des choses assez rares dans les films grand public (des « fuck » et des « shit » à chaque phrase, des tétons de strip-teaseuse, des mecs qui prennent de la drogue, une tournante à l’arrière d’une voiture, un avortement, un suicide, …)
 |
| Papa et Maman Manero |
« S.N.F. » (désolé je
vais commencer à abréger, je commence à trouver le temps long devant mon
clavier), c’est une tranche de vie de Tony Manero (Travolta of course), jeune
italo-américain de Brooklyn. Il bosse dans une quincaillerie, et le samedi
soir, comme c’est un bon danseur, il se met sur son trente et un et va,
accompagné de ses potes aussi bas du front que lui, foutre le feu au dancefloor
d’une boîte minable du quartier, espérant se faire remarquer (et plus si
affinités) de quelque gonzesse peu farouche … L’intrigue essentielle du film
sera pour lui de trouver une partenaire (et accessoirement de la sauter) avec laquelle
il pourra remporter un concours de danse dans sa boîte de prédilection … On en
connaît des films musicaux, tristes navets sonorisés où le script est aussi
mince (« Footlose », « Dirty dancing », « Flashdance »,
et foultitude d’autres ayant eu moins de succès) qui ne présentent aucun intérêt.
Dans « S.N.F. », on s’attaque aussi à la vie sociale et familiale de Tony Manero (le paternel chômeur, la mère femme au foyer, le frère aîné au séminaire et bientôt défroqué, la petite sœur mutine, et la vieille mama au bout de la table). Cet espèce de matamore en dehors de chez lui (parce que at home il prend des torgnoles s’il se tient pas bien) se fait enfumer par sa dulcinée totalement mytho (elle est secrétaire dans une agence de com, et lui fait croire qu’elle prend le café ou ses repas avec toutes les stars du ciné ou de la chanson qui passent en ville, et ça émeut fortement Tony, lui qui ne connaît même pas l’existence d’Eric Clapton ou de Laurence Olivier …). Pourtant, Tony, il en a des références. Dans sa piaule, y’a des posters de Rocky Balboa, Bruce Lee, Al Pacino, et côté meufs, Farah Fawcett en maillot de bain et Lynda Carter dans sa tenue de Wonder Woman. Et puis, le rêve de Tony et de ses bras cassés de potes, c’est une fois passé le Verrazano Bridge (dont il connaît tous les détails architecturaux et où lui et sa bande vont faire de l’équilibre sur les travées et les filins en sortant de boîte) de pouvoir aller à Manhattan, chez les gens « bien », dans cet autre monde … et « S.N.F. », contrairement à beaucoup de ses semblables longs-métrages, n’est pas un film avec une happy end … Même Tony a à peu près tout foiré, il garde son boulot minable, il essaie d’aller vivre avec sa partenaire à Manhattan, mais c’est pas gagné, et il s’est rendu compte qu’il y a des Blacks et des Porto-Ricains qui dansent mieux que lui … et en plus de victimes virtuelles du film, le pauvre Badham s’est fait virer par la Paramount le lendemain de la première (dialogues et scènes vulgaires, les gens de la vénérable maison ayant frisé l’apoplexie sur le plan en contre-plongée de Travolta en slip). Autres victimes collatérales plus tardives : les Bee Gees, dont le nom n’est pas prononcé une seule fois (faut le faire) au cours d’un doc de 30 minutes sur la musique du film (je suppose que des histoires de contrats, de droits, de royalties ayant fini au tribunal doivent expliquer ça)…
 |
| Helen, la vraie maman de Travolta |
« S.N.F. » a eu du
succès parce qu’il enquille les scènes fameuses, devenues cultes. Et ça
commence dès l’intro, pendant que défile le générique, où l’on voit Tony, un
pot de peinture à la main, marcher en rythme sur la musique de « Stayin’
alive ». Parenthèse, pour bien situer le côté fauché du film, pendant
cette scène inaugurale, Tony achète une part de pizza et une fois arrivé au magasin,
vent le pot de peinture à une femme d’un âge respectable qui l’attendait. La
marchande de pizza, c’est la sœur de Travolta, et la mamie dans le magasin, sa
propre mère …Et puis Travolta exécute de grands numéros de danse, certains improvisés.
Et sans être doublé. Il a refusé et est le plus souvent filmé de pied en cap
quand il danse (comme Fred Astaire, il l’a exigé) ce qui montre qu’il n’y a pas
de doublure. Enfin si, une fois, et même des années après, ça fout la rage à
Travolta quand il en cause, c’est le plan au début où il met sa chaussure en
face d’une exposée en vitrine pour juger de son effet. Et bien, c’est pas sa
jambe, il y a eu recours à une doublure, personne a jamais compris pourquoi,
juste pour lever la jambe devant une vitrine …
« S.N.F. », c’est
aussi un film qui fourmille de références. Pas seulement les posters dans la
piaule où le name dropping effréné de Karen Lynn Gorney. On sait pas si le
scénariste a pas eu suffisamment de temps ou si c’était une feignasse, mais
enfin … la boîte de Tony s’appelle le 2001 Odessey, la baston dans l’entrepôt
désaffecté avec les latinos très chorégraphiée est un copier-coller de celle
entre les Troogs et les Je-sais-plus-qui de « Orange mécanique », et
cette rivalité entre bandes renvoie à « West side story ». Et toute
la thématique et l’ambiance faussement joviale alors que des drames se nouent,
les bandes et les bagnoles, ça fait quand même un peu penser à « American
Graffiti ».
A contrario, quand Travolta et
Gorner sont assis sur un banc sur les quais surplombés par le Verrazano Bridge,
on trouvera quelques mois plus tard exactement le même plan filmé de l’autre
côté du fleuve par Woody Allen (lui et Diane Keaton sur un banc) dans, of
course, « Manhattan ».
Ma scène préférée : le
cours de danse disco pour troisième âge dans le local où va vont s’entraîner Travolta
et Gorner …
Conclusion (ouf …). Pas un
chef-d’œuvre, mais un très bon film culte …