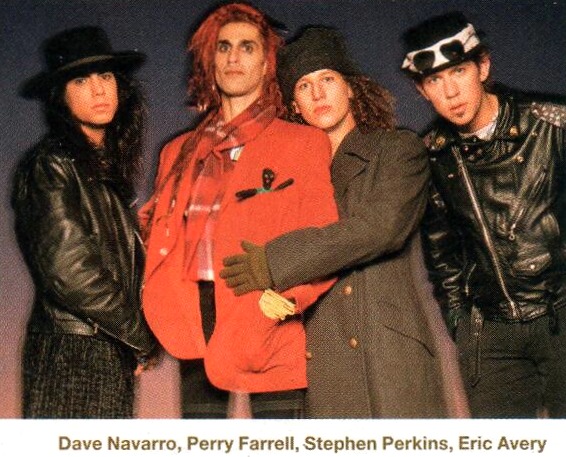Un Van de fraîcheur ...
Ils en étaient où, les chevelus du hard, en pleine
bourrasque punk ? Pas au mieux … un peu secoués, comme tous les notables
du rock-business, par tous ces jeunes iconoclastes à cheveux courts qui
n’hésitaient pas à brocarder, à jeter dans la même poubelle que les progueux,
les jazz-rockeux, les Claptoneux et les Stoneux, tous les Led Zep, Sabbath,
Kiss et Aerosmith …
Faut dire que pour le hard, c’était le temps qui
commençait à l’être, hard … Beaucoup n’étaient plus au mieux de leur forme
(Deep Purple, quelqu’un ?), et la sacro-sainte hégémonie anglo-américaine
se voyait contestée par des Irlandais (Thin Lizzy), des Australiens (AC/DC),
même les Teutons fourbissaient leurs armes et le « Tokyo tapes »
allait placer gagnant la Panzer Division des Scorpions … Le hard, c’était une
affaire de codes, de symboles. Du blues hypertrophié à grands coups de guitares
Gibson – amplis Marshall, et des auras mystérieuses, ténébreuses, entretenues à
grand renfort de tenues noires (Blackmore), de messes de la même couleur (le
Sabb), de propos ésotérico-mystiques (Blue Oyster Cult), de cabaret décadent
gore (Alice Cooper), d’heroic-fantasy corrigée à la mode Achille Zavatta
(Kiss), d’accointances avec l’occulte (Jimmy Page et son manoir de Crowley), …
Et puis, le hard, ça avait un côté prolo (jouer sans relâche, travailler la
technique à grands renforts de solos de tout ce qui tombait sous la main, en
donner au public pour son argent, plein de watts, de lights, …)
Curieusement, le hard allait se refaire la cerise là
où ne l’attendait pas, dans un de ces endroits où on le croyait proscrit. Los
Angeles (plus exactement sa banlieue, Pasadena), la ville du fric, de la
nonchalance et du soleil rois.
 |
| Elles est pas belle la vie des Van Halen ? |
Et tout ça, cette insouciance festive de beau gosse,
Van Halen allait le symboliser tout en reprenant à son compte et à sa manière
les fondamentaux du genre. Les trois premiers morceaux de ce disque, leur
premier, sont à bien des égards exemplaires. « Runnin’ with the
Devil », tout est dit dans le titre, on caresse le côté obscur de la chose
musicale (allusion transparente à Robert Johnson et son pacte faustien au
fameux crossroad, mais ici on sent bien que c’est pour rire).
« Eruption » qui suit, la démonstration technique insensée (le fameux
tapping d’Eddie Van Halen). « You really got me », la reprise des
anciens (même si les Kinks, c’est pas exactement du hard, mais ils l’ont
presque inventé avec ce titre). Tout est dit avec ce fabuleux (si, si) tiercé
introductif. Dans lequel perce déjà tout l’aspect rigolard qui sera la marque
de fabrique du Van Halen période David Lee Roth (et qu’on ne vienne pas me
parler de la version « sérieuse » avec Sammy Hagard).
Van Halen, c’est une affaire de potes, deux frangins
à la guitare et à la batterie, un alcoolo à la basse et le chanteur beau gosse,
souvent affublé de lycra moule-burnes, ce qui aura pour effet immédiat de faire
venir des légions de California girls aux concerts. Van Halen, c’est malin,
surtout au niveau sonore, loin de la purée de pois de la concurrence. Le cinquième
membre du groupe sera de fait Ted Templeman, le metteur en sons attitré des
Doobie Bros, parangons du son West-Coast bien léché. Van Halen deviendra le
Parrain du hard FM, basant tout sur la qualité mélodique nickel-chrome, et des
morceaux au format radiophonique (trois minutes chrono). Les headbangers de
base se grattèrent un peu la tignasse au début devant ce groupe bien loin des
schémas convenus, avant de lui faire un triomphe.
Faut dire qu’il y a de quoi réjouir tous les
amateurs de rock qui dépote, puisqu’on trouve également dans ce premier disque
quelques sérieuses ruades comme « Don’t talkin’ » ou « On
fire ». et puis, ce qui sera aussi une marque de fabrique du groupe,
quelques potacheries second degré (« I’m the one » du rockabilly
hard ?, « Atomic punk » !?, « Ice cream man »
country à la sauce jumpbilly ?) qui ont dû hérisser les purs et durs du
métal lourd. Et puis, comme on sent un peu l’influence d’Aerosmith (« Feel
your love tonight »), les Van Halen ont glissé la ballade très Tyler-Perry
« Jamie’s cryin’ » le truc imparable pour faire fondre les
programmateurs radio FM.
Cette première salve a eu un succès considérable.
Les rares hardeux qui renâclaient devant cette bourrasque de bonne humeur
communicative ont de toute façon ramassé son successeur « Van Halen
II », beaucoup plus « méchant » en pleine poire. Van Halen a
pris son temps, mettant pendant cinq ans les USA à ses pieds à coup de tournées
incessantes, avant de faire succomber le reste du monde avec « 1984 »,
leur plus gros succès mais aussi le début de la fin …
Des mêmes sur ce blog :
1984
Des mêmes sur ce blog :
1984