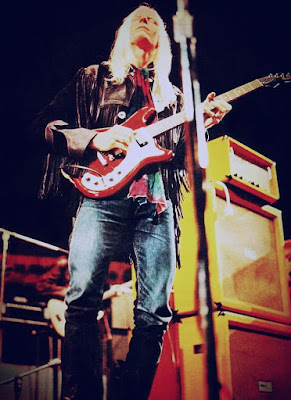Chemin de croix ...
« Vivre sa vie » est sous-titré « Film en douze tableaux ». Du strict point de vue du montage, des intertitres séparent des groupes de scènes et annoncent sommairement ce qui va suivre. Douze tableaux comme il y a quatorze stations du Chemin de Croix … Même si « Vivre sa vie » n’est pas un film religieux. Au mieux, on frôle le mysticisme quand Godard, dont il n’est pas inutile de rappeler qu’il fut d’abord critique et donc fan de cinéma, insère une scène qui s’annoncera prémonitoire, celle de l’annonce à Jeanne d’Arc de sa condamnation dans le chef-d’œuvre de Dreyer « La passion de Jeanne d’Arc » avec ce long gros plan sublime sur le visage d’Andrée Falconetti, une des scènes les plus expressives jamais mises en images.
 |
| Godard & Anna Karina 1962 |
Godard a toujours aimé la
symbolique, suggérer plutôt que montrer, ce qui n’est pas forcément plus simple
ou évident. Mais Godard, encore à l’orée de sa carrière (« Vivre sa
vie » n’est que son quatrième long-métrage, et il n’a qu’un chef-d’œuvre,
« A bout de souffle », à son actif) estime avoir des dettes à payer
au septième art, tout en suivant une voie profondément originale. Ce qui
occasionne des tensions. Avec à peu près tous ceux qui sont les plus importants
lorsqu’il met en chantier ses films.
Godard envisage son art d’une
façon unique à l’époque, et surtout n’aime pas les concessions. Comme beaucoup
de ses films des sixties (vive la censure gaullienne), « Vivre sa
vie » va se retrouver interdit aux moins de dix-huit ans. Faut dire que
faire un film sur la prostitution et « offrir » au spectateur-voyeur
de l’époque quelques images (certes fugaces) gratuites de seins et de fesses ne
risquait pas de le réconcilier avec la triste bien-pensance de la censure de
l’époque. Il ne se foutait pas de la censure, il la cherchait …
Des concessions, Godard n’en
fera pas plus à la production. Lâché par son premier et historique financeur Georges
de Beauregard, il trouvera comme producteur Jean Schlumberger, à qui il
refusera un petit second rôle pour sa femme, avant d’entrer en conflit ouvert
avec lui (des rumeurs, comme d’habitude serait-on tenté de dire sur les
tournages de Godard, font état de bagarres entre les deux et au moins de
situations très tendues bien réelles).
La censure et la production sur le dos, ça peut déjà faire beaucoup pour un seul homme. Godard ne s’arrête pas là. Bien que son mariage prenne l’eau, il confie à sa femme Anna Karina le premier rôle, et prendra quasiment un malin plaisir à lui imposer multitudes de choses qu’il n’est pas sans savoir qu’elle va détester (sa coupe de cheveux, ses fringues, de nombreuses situations et répliques, …).
 |
| L'amour tarifé ... |
Certes à peu près tout ce qu’a
fait Godard dans les sixties mérite d’être vu, mais bien peu se hasardent à
citer « Vivre sa vie » comme un de ses films majeurs. Même si on y
trouve tout ce qui symbolise le meilleur cinéma de Godard. Les personnages
antisystèmes d’abord. Ceux qui sont en marge de la société et se foutent donc
des codes de la société. Anna Karina est Nana. Une allusion au personnage du
même prénom de Zola. Même si la trajectoire de la Nana du film évoque plus celle
de sa mère (la Gervaise de « L’Assommoir ») dans la saga de Zola.
Nana vivote dans son boulot de vendeuse de disques dans un magasin d’électro-ménager (même s’il ne comprend rien à la musique de son époque, Godard lui donne toujours une place importante dans ses films). Elle se fait larguer par son mec (superbe premier « tableau », scène de rupture pendant laquelle les deux protagonistes sont filmés de dos au zinc d’un bistrot, on ne voit leurs visages flous de face que dans le reflet des glaces du comptoir), se fait courser par sa logeuse parce qu’elle lui doit du fric qu’elle essaye de trouver en vain auprès de ses connaissances. Dès lors, d’abord occasionnellement ensuite régulièrement, Nana va se prostituer, sans qu’on sache et comprenne vraiment ce qui la pousse sur le trottoir.
 |
| Nana au cinéma |
Dès lors, la prostitution va
devenir le fil conducteur du film. Bon, Godard ne fait pas ici du cinéma social
(même si « Vivre sa vie » doit bien plaire à Ken Loach), il marche plutôt
sur les traces du réalisme désincarné de Bresson, un des théoriciens de la
Nouvelle Vague. Il aurait même reconnu l’influence du néo-réalisme italien, et
plus particulièrement de Rossellini, ce qui se tient … Le point de départ de « Vivre
sa vie » étant un très sérieux rapport de Marcel Sacotte, juge de son
état, intitulé « Où en est la prostitution ? » (ce qui donne l’occasion
à Godard au cours d’une scène en voiture de faire tenir à ses personnages un
très didactique dialogue sur le mode question-réponse sur le thème de la
prostitution, sa tarification, l’organisation de la hiérarchie mac-tapineuse,
etc …).
Anna Karina traverse cette histoire qui finit mal en roue libre (on la sent pas toujours très concernée). Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur la façon très particulière et freudienne qu’a Godard de mettre en scène la femme dont il est en train de se séparer. Il la fait coiffer façon Louise Brooks sachant pertinemment qu’elle déteste les coupes à la garçonne, invente quasiment le système d’oreillette pour lui donner des ordres sur le tournage, elle manque se faire écrabouiller par une voiture, et finira par une tentative de suicide aux barbituriques. Autant dire qu’elle n’est pas aussi irradiante que dans « Pierrot le Fou », période à laquelle sa relation avec Godard était beaucoup plus claire (ils venaient de divorcer). Elle arrive cependant à sublimer une paire de scènes, lors de la projection de « La passion de Jeanne d’Arc » où ses larmes viennent répondre à celles d’Andrée Falconetti à l’écran, ou lors d’une danse endiablée au milieu de macs dans une salle de billard. Elle est par contre assez à l’Ouest lors d’une discussion philosophique dans un bistrot avec un intellectuel oublié (Brice Parrain), lors d’une longue scène (bien dix minutes) totalement hors sujet par rapport au reste du film, technique récurrente chez Godard pour faire au grand n’importe quoi, alors qu’il a ça en tête depuis le début du tournage …
 |
| Un final à bout de souffle ... |
Et comme si ça ne suffisait pas,
Godard doit faire face au départ au milieu des prises de vue de l’indispensable
chef-opérateur Raoul Coutard, engagé sur un autre tournage alors que celui de « Vivre
sa vie » s’éternise.
Pour l’anecdote, alors que
passe dans un bar la chanson de Jean Ferrat « Ma môme », c’est le
chanteur lui-même que l’on voit accoudé au jukebox.
En fait on se demande si pour « Vivre
sa vie » tout n’était pas dit dans le générique d’entrée (« ce film
est dédié aux fans de série B »). Même si les thématiques de la série B
américaine sont là (les marginaux, rebelles, les catins, les voyous), même si
la fin renvoie étrangement à celle de « A bout de souffle », il
manque ce petit quelque chose qui peut faire d’une série B un grand film …
A noter que le film remastérisé
en haute définition ne semble disponible en Blu-ray qu’en import anglais (chez la
boîte d’édition BFI). Avec beaucoup de bonus, dont notamment trois
courts-métrages assez rares de Godard (« Charlotte et Véronique »
avec scénario d’Éric Rohmer, « Une histoire d’eau » co-réalisé avec
Truffaut et « Charlotte et son Jules » avec un Belmondo doublé étrangement
dans la VO pourtant en français). Par contre la version commentée du film (par
un critique de cinéma … australien) et une longue d’interview de Karina en 1973
par un journaliste qui parle beaucoup plus qu’elle, ne sont disponibles qu’en
anglais. J’ai pas l’impression qu’on perde grand-chose d’après les bribes
écoutées …
Du même sur ce blog :
A Bout De Souffle (1960)
Le Mépris (1963)
Pierrot Le Fou (1965)
Masculin Féminin (1967)