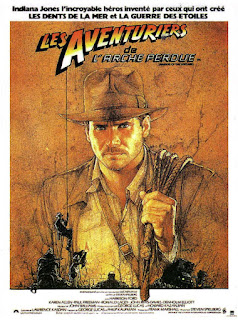Le Mépris ...
« Tu les trouves jolis, mes hits ? »,
« Et mes ambiances celtiques ? », « Et mes titres
expérimentaux, tu les trouves jolis ? » …
Oui, Kate, je les trouve jolis …
Mais comme le chef-d’œuvre de Godard, le chef-d’œuvre de Kate Bush n’est pas un truc facile. Ça peut rebuter … Parce que « Hounds of love » est un disque déstabilisant, une Œuvre, sans le côté prétentieux qu’on attribue généralement au mot.
Kate Bush est une artiste atypique. Rattachée quasi accidentellement au rock-pop-machin. Elle vient de la musique et de la danse classiques, comme toute bonne fille de famille bourgeoise anglaise qui se respecte dans les années 70. Premier choc, elle aurait (conditionnel, mais imprimons la légende) fait partie (à 15 ans) des quelques centaines de privilégiés qui assistent à la « mort » de Ziggy Stardust le 3 Juillet 1973 au Hammersmith Odeon. Quelques semaines plus tard chez ses parents, elle joue en s’accompagnant au piano des chansons qu’elle a composées, devant l’ami d’un ami de la famille. Qui s’appelle David Gilmour et promet que quand Pink Floyd lui laissera un peu de temps libre, il amènera la gamine en studio. Il faudra attendre trois ans pour les premières séances, et deux de plus pour la sortie du premier single « Wuthering Heights ». Number one dans les charts anglais, une première pour une femme auteur-compositeur-interprète. Le fait que tous les collégiens anglais aient lu « Les hauts de Hurlevent » aidera au succès du titre. Mais la mélodie difficile au piano et les trois octaves (comme Joan Baez ou Laura Nyro, liste à peu près close) tout en haut des aigus de Kate Bush n’y sont pas pour rien. Et pendant deux ans, Kate Bush va voir sa popularité croître. Elle sort des disques, assure la promo. Et donne des concerts. Au sujet desquels le mot féérique est celui qui revient le plus souvent (les fringues à base de voiles vaporeux, la chorégraphie venue de ses années de danse classique, les fumigènes, les ambiances lumineuses en clair-obscur). Dès le départ, Kate Bush contrôle tout, et forcément, les frictions avec le music busines (EMI en l’occurrence) pointeront vite le bout de leur sale museau. En 80, basta, Kate Bush fait savoir qu’on ne lui imposera rien, qu’elle fera des disques quand elle en aura envie et qu’elle ne se produira plus sur scène (elle tiendra parole plus de trente ans). Un autre gros hit (« Babooshka ») la met définitivement à l’abri du besoin. Afin d’être totalement autonome, elle se fait construire son propre studio, et hormis son bassiste-compagnon Del Palmer, n’a plus de « groupe » attitré, elle emploie des musiciens au gré des besoins de ses titres. C’est elle qui produira ses disques, remixant ou réenregistrant complètement (comme Manset) des titres lors de rééditions ou sorties de compilations … Le fameux « Complete Control » que n’a jamais eu le Clash, c’est cette petite bonne femme qui l’obtiendra …
Revers de la médaille, vers le milieu des 80’s, Kate
Bush décline commercialement, l’Angleterre faisant une fixation sur les
« nouveautés », encensées un jour, portées au gémonies le lendemain.
Lorsque qu’elle s’attaque fin 83 à « Hounds of love », son cinquième
album, Kate Bush ne peut plus tenir sur ses acquis. Elle doit convaincre. Et
évidemment, elle va s’y prendre d’une façon assez singulière. « Hounds of
love » est à peu près ce qu’on a l’habitude de qualifier de suicide
commercial. Un concept-album pour faire simple. Comme tous ceux qui font de la
musique « sérieuse », c’est-à-dire prétentieuse et insupportable.
Sauf qu’avec Kate Bush ça ne se passe comme avec tous les vulgaires
maltraiteurs de gamme œuvrant dans le prog, genre auquel on l’a quelquefois
paresseusement rattachée. « Hounds of love » est un disque « à
l’ancienne » et novateur en même temps. A l’heure où il n’est plus
question que de raisonner en termes de Cd, « Hounds of love » est
conçu comme un trente-trois tours. En gros, une face chanson (« Hounds of
love ») et une face expérimentale (« The ninth wave »).
La face « chansons » générera quatre singles (pour cinq titres). Plus connu, le titre d’ouverture, "Running up that hill". Polyrythmies ondulantes, mélodie complexe, évolutive, mais instantanément mémorisable, voix comme d’hab très haut perchée, "Running up that hill" finira en troisième position des hits anglais. Un titre immortel, ne serait-ce que parce qu’il a eu plusieurs vies. Kate Bush le remixera en 2012 à l’occasion des J.O. de Londres. Sixième dans les charts. Et puis l’improbable total se produira. En 2022, Kate Bush est contactée par les producteurs d’une série télévisée Netflix, « Stranger things », qui veulent utiliser le titre comme générique de leur prochaine saison. Discussions, accord. Et là, en quelques semaines, le titre devient viral sur les réseaux sociaux pour « jeunes ». Records de streaming sur Spotify, heavy rotations sur les radios, et titre qui trente sept ans après sa sortie devient numéro un dans plusieurs pays dans sa version originale, du jamais envisagé, même pas en rêve par qui que ce soit … "Running up that hill" est forcément le titre classique de Kate Bush. Mais pour moi il y a encore mieux sur ce disque. C’est « Cloudbusting », chanson au thème pour le moins étrange, morceau en hommage à un inventeur malade (Peter Reich) du cloudbuster, machine censée faire pleuvoir en utilisant des particules orgasmiques présentes dans l’atmosphère. Un titre qui suit une progression d’accords inexorable, et il me semble bien assez similaire au « Boléro » de Ravel. Pour moi de loin la masterpiece de toute la carrière de Kate Bush, avec un clip « expended » scénarisé par Terry Gillian, avec Donald Sutherland dans le rôle du maboule professeur et Kate Bush dans celui de son fils. Apparemment un titre trop bon pour les charts de l’époque, où il ne fit qu’une carrière modeste.
Sont également sortis en singles le morceau-titre
« Hounds of love » (grosse batterie hyper compressée, musique
linéaire, tout repose sur la voix de Bush) et « The big sky »,
ballade emphatique, lyrique avec des schémas complexes, qui évoque fortement le
son de « So » le disque de Peter Gabriel qui sortira l’année suivante
(normal, les deux s’appréciaient, échangeaient beaucoup, et Kate Bush
participera à plusieurs morceaux du Gab, qu’elle ne sauvera pas toujours de la
médiocrité, voir ou plus tôt écouter « Don’t give up »). Dernier
titre de la face « Hounds of love », la belle ballade « Mother
stands for comfort » qui ne dépare en rien le niveau très élevé de cette
première partie du disque.
La suite (car la plupart des titres sont enchaînés) « The ninth wave » réussit à agglomérer tout et son contraire, des épures au piano à de l’expérimental total. Surprenante au premier abord, cette « suite » se mérite. Du piano-voix inaugural (« And dream of sheep »), à la légèreté finale de « The morning fog » (on boucle la boucle, c’est très proche du son, de l’ambiance et des rythmes de la première face). En utilisant des bandes accélérées et/ou passées à l’envers, des dialogues de films, des brisures de rythmes (« Waking the witch » en est le meilleur exemple, avec en plus un sample des hélicos qu’on entend sur « The Wall » du Floyd). Autant le vague concept de la première partie a du sens avec ses ambiances ou paroles mystiques ou ésotériques (elle devait s’appeler au départ « A deal with God », l’expression n’a été conservée que comme sous-titre de la chanson « Running up that hill »), autant j’ai jamais compris cette histoire de neuvième vague tant elle rassemble des titres hétéroclites. Alors c’est expérimental (dans la mesure où c’est pas des choses qu’on entend généralement dans un disque « grand public », et surtout pas le temps d’une face vinyle entière), mais c’est facilement abordable, très écoutable (sinon, Kate Bush ou pas, j’aurais dit que c’était de la daube). Deux titres sont plus « faciles » de prime abord, le très celtique « Jig of life » (enjoué, entraînant, qui ne déparerait pas le répertoire des Chieftains et rendrait tous nos bardes chevelus bretons plus supportables), et la pièce majeure de cette face « Hello Earth ». Ce bonjour à la Terre est le morceau le plus long du disque (plus de six minutes, commencé comme une ballade, le chant grégorien d’une chorale en partie centrale, des voix murmurées et des synthés pour finir).
Lors de sa sortie, « Hounds of love »
renforcera si besoin était la crédibilité et l’originalité artistique de Kate
Bush. Malgré ses quatre singles, ce sera une bonne vente sans plus. Très
certainement en dessous des objectifs d’EMI, qui n’attendra que quelques mois
pour sortir une compilation (« The whole story », un seul inédit, pas
extraordinaire), mettant un terme à la première partie de l’œuvre de Kate Bush.
Qui dès lors, se fera beaucoup plus rare discographiquement (quatre albums en
vingt deux ans). Bizarrement, alors que dans le « métier » on fait
tout pour faire parler de soi et perdurer pour rester en haut de l’affiche,
plus Kate Bush se fera discrète, plus elle sera citée comme référence (et pas
seulement dans le milieu musical) …
« Hounds of love », c’est classique et novateur
en même temps … comme les meilleurs Godard …
De la même sur ce blog :